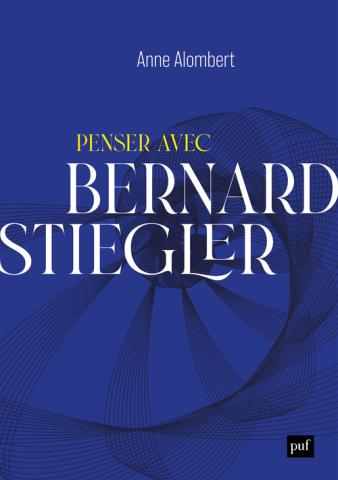C’est un plaisir de se plonger dans cette première vue d’ensemble des travaux du philosophe le plus original de notre époque d’absence d’époque qu’a été et qu’est toujours Bernard Stiegler qui s’est donné la mort, il y a cinq ans, le 5 août 2020.
Bernard Stiegler fait partie des philosophes qui ne se contentent pas d’interpréter le monde mais travaillent à le transformer. Il en a bien besoin. Cela veut dire aussi contribuer à transformer la philosophie elle-même. C’est aussi un philosophe au parcours singulier puisque sa « conversion » à la philosophie s’est effectuée en prison.
La caverne carcérale
Le milieu carcéral a été pour Bernard Stiegler une localité d’un type particulier. D’abord la sanction d’un passage à l’acte, l’arme au poing, par lequel il tentait de braquer une banque qui lui refusait un renouvellement de crédit pour sauver le bar à jazz, L’écume des jours, qu’il avait monté à Toulouse. Le flagrant délit, après deux autres attaques à main armée, le fera condamner à huit années de réclusion. Il en effectuera cinq. Bernard Stiegler racontera cette « expérience de suspension » dans son livre Passer à l’acte (Galilée 2003) ainsi que dans un livre d’entretien Philosopher par accident (Galilée 2004). Passage à l’acte est à comprendre aux deux sens du terme, à la fois comme transgression de la loi et comme passage à l’acte philosophique. Ce dernier passe lui-même par une intense réflexion sur l’acte de lecture puis d’écriture.
Anne Alombert nous rappelle tout cela dans le prologue de son livre Penser avec Bernard Stiegler. qu’elle vient de publier (Puf, 2025). Elle y souligne que le philosophe procède à « un profond renversement » de l’allégorie de la caverne de Platon qui devient celle du poisson volant qui effectue par intermittence un saut dans l’air, un saut hors de son milieu, l’eau. Si le milieu hors les murs fait défaut au prisonnier, il continue cependant d’exister dans la mémoire collective à travers des artefacts, les livres ou les cours par correspondance, par exemple.
Il avait affiché sur un mur de sa cellule ces vers de Mallarmé :
Ma faim qui d’aucuns fruits ici ne se régale
Trouve en leur docte manque une saveur égale.
Il ne lisait pas seulement des ouvrages de philosophie. Ses textes sont émaillés de références littéraires. Pour Bernard Stiegler, en prison, le passage à l’acte de lecture consistait à la fois dans l’acte de lire, de temporaliser un objet spatial, le livre, et de spatialiser ses lectures par des annotations, commentaires et synthèses.
Le refoulé de la philosophie
Dans la première partie de son livre, Anne Alombert traite des différents temps de la philosophie et de l’indissociable action politique et sociale de Bernard Stiegler, le temps de l’étude, de la thèse, de la crise du capitalisme consumériste et analogique, le temps de la fin. Enfin, celui de l’anthropocène.
Que signifie se demande-t-elle de parler de la technique comme « impensé « et comme « refoulé » de la philosophie ? Rappelant que Stiegler a bien lu des philosophes qui se sont intéressés à la technique tels Karl Marx, Henri Bergson, Martin Heidegger, Günther Anders, Hannah Arendt, Jacques Ellul, Gilbert Simondon…, elle explique :
« Le problème est […] moins celui du refoulement de la technique en tant que telle que celui de l’opposition entre savoir et technique ou entre pensée et technique, qui témoigne de l’oubli de la technique comme condition des savoirs ou de la pensée ». (p.56)
J’ai évoqué cette question ici avec des extraits de l’intervention de Stiegler dans le film The Ister sur le mythe de Prométhée et d’Epiméthée. Il n’y a pas de pensée hors du milieu technique qui la conditionne. Ce point de vue permet de dépasser les dichotomies entre intelligible et sensible, esprit et matière, conscience et monde, intériorité et extériorité, etc… Cette sortie du raisonnement binaire oblige en quelque sorte à l’invention de nouveaux concepts qui perturbent les routines, pour penser autrement. Pas pour le simple plaisir de penser autrement mais parce que les nouvelles conditions technologiques l’imposent en rendant les vieilles catégories métaphysiques obsolètes.
« S’il fallait résumer le geste de Stiegler en une phrase, sans doute pourrait-on dire qu’il s’agit pour lui de transformer le discours philosophique et ses catégories oppositionnelles, afin de penser le rôle constitutif des supports techniques dans les temporalités psychiques et historiques dans le but de panser le fait historique de l’industrialisation de l’esprit, qui soulève des enjeux politiques inédits ». (p. 63)
Misère symbolique
Après le temps de sa thèse intitulée La technique et le temps, qui restera inachevée,
« la question de la réconciliation des avancées technoscientifiques et technomédiatiques avec les savoirs locaux et singuliers sera au cœur des futures réflexions de Stiegler, dans un contexte où, à l’inverse, l’hyperindustrialisation semble engendrer une prolétarisation et une désaffection grandissantes des individus » (p.75)
Et les publications de Bernard Stiegler se rapprochent d’une philosophie d’intervention qui, loin d’abandonner les questions de fond, s’appuient sur une interprétation philosophique d’une série de symptômes politiques et sociétaux qui les expriment. Dans le même temps, le philosophe se livre à une relecture conjointe des travaux de Freud et de Marx. Pour le premier ce sera la question du désir, pour le second, celle de la prolétarisation.
Il procède à l’analyse d’une triple crise : celle du capitalisme consumériste et financiarisé qui atteint ses limites structurelles en raison de l’épuisement des ressources naturelles et psychiques ; une crise politique « notamment provoquée par l’avènement du psychopouvoir télévisuel et du populisme industriel » ; Une crise existentielle en raison de l’état de « misère symbolique » qui frappe nos sociétés. La collision de ces trois crises conduit à
« des passages à l’acte violents ou encore à la persécution de boucs émissaires servant d’exécutoires à une souffrance dont les causalités économico-politiques demeurent non identifiées » (p. 78).
Le brouillard idéologique sciemment diffusé par un psychopouvoir a pour fonction de faire passer les effets pour des causes en exploitant les pulsions. Stiegler distingue ces dernières du désir qui consiste précisément à les différer et les sublimer. Au lieu de se laisser submerger par les pulsions, l’on prend soin des objets que l’on désire. Le capitalisme pulsionnel détruit les désirs et prive les individus de participation à la production de symboles. La notion de « misère symbolique » signifie que les individus sont « privés des symboles esthétiques, culturels, artistiques, scientifiques ou encore politiques qui donnent sens à leur existence » (p.80). Et j’ajouterais : quand bien même ils ne souffriraient pas d’un manque de moyens de subsistance.
Anne Alombert montre bien que Bernard Stiegler est un philosophe à part entière et pas seulement un « philosophe de la technique » en ce qu’il s’inscrit pleinement dans la tradition philosophique. Dans la première partie, elle évoque cette articulation entre philosophie et engagement politique et social qui le caractérise :
« Qu’il s’agisse de l’association Ars Industrialis, source de propositions politiques et économiques, de l’Institut de recherche et d’innovation, lieu de développement d’instruments numériques contributifs, du réseau Digital Studies, réseau de recherches trans-disciplinaires ou de l’école Pharmakon, école de philosophie internationale, ouverte et populaire, les différents projets élaborés par Stiegler durant les dix années qui suivent la publication de sa thèse témoignent donc d’une étroite articulation entre ses réflexions philosophiques, les champs politiques et économiques, la sphère de la recherche et de l’enseignement et le domaine du développement technologique et industriel. Ils témoignent aussi de la manière inédite selon laquelle Stiegler entend pratiquer la philosophie : non seulement en écrivant et en publiant des livres (ce qu’il fait abondamment, à raison d’environ un livre par an) mais aussi en instituant et en participant à des projets collectifs sur le long terme, porteurs de propositions et d’initiatives concrètes sur les plans politiques, culturels, économiques, technologiques, académiques et éducatifs. » (p.94)
L’humanité « en panne d’essence ».
J’adore cette expression qui ne signifie pas ici une panne de carburant encore que de ce point de vue nous assistions à l’épuisement de certaines ressources fossiles traditionnelles ce qui ne veut pas dire que l’on en ait fini avec l’extractivisme (lithium, terres rares…). Cela veut dire qu’il n’y a pas d’essence humaine. L’invention de l’homme et celle de la technique sont une seule et même chose. Stiegler s’appuie sur les travaux du paléoanthropologue André Leroi-Gourhan qui avait montré que
« la technique constituait moins un moyen au service d’un supposé sujet humain qu’un processus d’extériorisation corrélatif du processus d’hominisation » (p.121)
Il ne s’agit donc pas d’un « humain » déjà là qui aurait eu un jour l’idée de tailler du silex. L’extériorisation et l’intériorisation se font dans une relation dite « transductive » où aucun des termes ne peut exister sans l’autre et où l’essentiel se situe dans la relation de l’un à l’autre. Le silex taillé contient en même temps la mémoire du geste qui l’a produit. Il s’agit dès lors de penser la technique
« non plus comme moyen mais comme milieu et comme mémoire : comme milieu mémoriel, support des expériences passées et des attentes à venir ». (p.191)
A l’idée d’humanisme se substitue la notion d’ individuation psychique et collective qui désigne un devenir humain à la fois individuel et collectif.
La troisième mémoire / rétention tertiaire
A côté de la mémoire génétique, somatique et nerveuse dans lesquelles sont inscrits les vécus individuels, Stiegler propose d’appeler « mémoire épiphylogénétique » une troisième mémoire collective et technique qui permet de transmettre aux individus une histoire qu’ils n’ont pas eux-mêmes vécue. Le livre en est l’exemple le plus flagrant. Il est spécifiquement conçu pour la conservation et la transmission de l’héritage.
La lecture de Edmund Husserl permet à Stiegler d’inventer le concept de rétention tertiaire. Le philosophe allemand avait proposé les notions de rétentions primaire et secondaire ainsi que celle de protention (attente d’un à venir). La première est la mémoire immédiate qui consiste, par exemple, à retenir le début d’une phrase permettant d’entendre la suite, la seconde est par exemple la mémoire de l’enfance. Stiegler y ajoute celle, tertiaire, contenue dans les supports techniques et technologiques. Les métamorphoses de cette dernière modifie nos façons de lire, d’écrire et de penser.
« Une fois admise la thèse générale selon laquelle les structures et activités de l’esprit se transforment en fonction des évolutions des supports mnémotechniques, l’enjeu consiste à décrire ces transformations en étudiant les spécificités de chacun de ces supports, du point de vue de leurs effets sur les rapports au temps, sur les consciences et sur les inconscients. Les principales technologies d’enregistrement étudiées par Stiegler sont les suivantes : les rétentions tertiaires littérales qui désignent les enregistrements des flux de paroles ou de pensées à travers l’écriture alphabétique puis l’imprimerie, le livre et la presse ; les rétentions tertiaires analogiques phonographiques et photographiques qui désignent les enregistrements des flux de sons et de lumières dans les sillons des disques ou sur le papier photosensible ; les rétentions tertiaires analogiques cinématographiques qui désignent les enregistrements des mouvements animés à travers les films projetés sur les écrans ; les rétentions tertiaires analogiques télévisuelles, qui désignent les enregistrements des événements « en direct » ou « en temps réel » à travers les émissions de télévision ; et les rétentions tertiaires numériques qui désignent les enregistrements des interactions et des comportements à travers les supports électroniques sous forme de données informatiques. […]
Chacune des rétentions tertiaires ouvre de nouvelles possibilités temporelles pour les esprits (de nouvelles possibilités de se souvenir, de percevoir et d’imaginer), mais avec elles aussi, de nouveaux risques et de nouveaux dangers.
La perspective de Stiegler doit donc aussi être qualifiée de « pharmacologique » : ses analyses ne cessent de souligner l’ambivalence des supports techniques du point de vue de leurs effets sur les esprits individuels et collectifs, qu’elles peuvent à la fois soutenir et intensifier ou détruire et décomposer. Stiegler reprend à son compte la notion de pharmakon que mobilisait Platon pour souligner l’ambiguïté de l’écriture, à la fois remède et poison pour la mémoire et le savoir. Selon Stiegler, cette dimension « pharmacologique » des supports techniques, mise au jour par Platon dans le cas de l’écriture, vaut aussi pour tous les autres types de supports d’enregistrements. Ceux-ci sont nécessaires à la production, à la transmission et à l’évolution des savoirs mais peuvent aussi devenir des dispositifs de pouvoir, au service de la manipulation des esprits et du contrôle des comportements. L’analyse pharmacologique se double alors d’une analyse politique, étudiant les nouveaux modes de pouvoirs rendus possibles par les industries culturelles télévisuelles et les industries des traces numériques. » (p.149-151)
Anne Alombert approfondit du point de vue pharmacologique ces quatre dimensions qui en outre s’industrialisent et favorisent ainsi l’apparition d’un psychopouvoir télécratique puis d’un noopouvoir numérique.
Prolétarisation
En 2009, Bernard Stiegler met en débat, sous forme d’un livre, la nécessité d’une Nouvelle critique de l’économie politique. A partir de sa lecture de Marx, il développe et approfondit le concept de prolétarisation qu’il analyse d’abord comme une perte de savoirs. J’en ai parlé à l’occasion de l’une de mes (re)lectures de Marx.
Anne Alombert résume ainsi les dynamiques de prolétarisation :
« Si la classe ouvrière est la première classe touchée par la prolétarisation à travers l’extériorisation des savoir-faire dans les machines outils qui se développent dans les usines au XIXè siècle dans le contexte de la révolution industrielle, Stiegler insiste sur le fait que le processus d’extériorisation des savoirs dans les machines et appareils n’a cessé de se poursuivre depuis, notamment à travers l’extériorisation des savoirs-percevoir et des savoir-vivre dans les appareils d’enregistrement analogique (radio, cinéma, télévision) mais aussi, à travers l’extériorisation des savoir-penser dans les machines informatiques et algorithmiques. Dès lors, le processus de prolétarisation ne concerne pas seulement les savoir-faire des ouvriers ou des producteurs, mais aussi les savoir-percevoir des téléspectateurs, les savoir-vivre des consommateurs ou les savoir-penser des concepteurs et décideurs ». (p.236)
Elle précise utilement concernant les savoir-vivre, qu’il s’agit là des arts de vivre, des rythmes et rituels sociaux, des traditions et habitudes locales « qui font l’objet d’une transmission et d’une transformation intergénérationnelle ». Dès lors l’enjeu est celui d’une nouvelle économie politique industrielle reposant sur la déprolétarisation et la désautomatisation, c’est à dire la nécessité de repenser le travail pour qu’il redevienne l’expression d’un savoir et de définir la richesse comme procédant des savoirs.
Écologies et entropies dans l’ère Entropocène
La notion d’Anthropocène pour désigner la nouvelle ère géologique dans laquelle nous vivons a ceci de problématique qu’elle repose sur la notion d’anthropos, l’humain en grec, et désigne l’humanité en général là où il faudrait mettre en cause un système économique, par exemple le Capitalocène.
Bernard Stiegler y substitue la notion d’Entropocène qui
« ne repose plus sur l’opposition entre une humanité technicienne et une nature originaire, mais implique au contraire d’appréhender le lien intrinsèque entre la destruction des écosystèmes, des espèces et de la biodiversité (décrite comme une augmentation d’entropie au niveau environnemental, physique et biologique) et la destruction des savoirs, des cultures et de la socio – ou noo- diversité (décrite comme une augmentation d’entropie au niveau informationnel, psychique et collectif) ». (p.287).
Avant d’aller plus loin, Anne Alombert nous propose une « brève histoire conceptuelle de l’entropie » d’abord apparue dans la physique thermodynamique, puis dans les sciences du vivant, ensuite dans le domaine informationnel et enfin dans le champ social et mental. Elle montre que Stiegler s’est efforcé de clarifier cette notion empirique mais transdisciplinaire d’entropie et son corollaire la néguentropie pour en faire un concept qui intègre la vie technique. En résumé, l’anthropocène est un entropocène en ce que l’on y distingue l’entropie thermodynamique, l’entropie biologique, l’entropie informationnelle.
« De même que l’entropie désignait la tendance à la destruction, à l’homogénéisation et à l’inertie au niveau physique, et la néguentropie et l’anti-entropie les tendances à l’organisation, à la diversification et au renouvellement caractéristique du vivant, les concepts d’anthropie et de néganthropie ou d’anti-anthropie sont mobilisés par Stiegler pour désigner ces tendances au niveau de la vie technique, psychique et sociale » (p.322)
Comme le GIEC parle de forçage anthropique (gaz à effet de serre, aérosols, déforestation, etc.) pour le distinguer des forçages naturels ayant des effets sur le climat, la proposition est de substituer au couple Entropie/néguentropie celui d’Anthropie/Néguanthropie
L’économie, dès lors, se situe dans un rapport entre anthropie / néguanthropie et doit donc être conçue pour permettre de bifurquer de l’Anthropocène vers un Néganthropocène. Il y a urgence car les processus d’exosomatisation entièrement sous la coupe du marché et en cela niés par les puissances publiques ne sont plus seulement toxiques mais sont devenues mortifères. Par ailleurs le transhumanisme a avancé la notion inepte d’extropie, un totalitarisme à la tronçonneuse qui s’attaque à l’importance des savoirs pour lutter contre les tendances délétères des artefacts techniques et industriels.
Le rôle des savoirs