 Ecrire le temps,
Ecrire le temps,
le temps qu’il fait,
le temps qui passe,
…
Ecrire le temps,
le beau temps
le bon temps
le mauvais temps,
temps de l’Histoire avec une grande hache /
temps rivé au poteau de l’instant
…
critiques cryptiques allégoriques prosaïques symphoniques nombriliques
vendredi 27 février 2015
je vous invite à disséminer des textes qui tiennent
La Chronique
Je remercie Laurent Margantin pour m’avoir autorisé à publier son texte repéré sur le site de La revue des ressources. C’est le deuxième volet de la chronique berlinoise sur le SauteRhin, après le mien : Au son d’une lyre crétoise. Il sera suivi d’autres.
On peut découvrir les écrits et traductions (notamment Kafka !) de Laurent Margantin sur son blog Oeuvres ouvertes
ECLATS D´UNE VILLE
Notes sur des ruines géopolitiques
par Laurent Margantin

Berlin Chaussestrasse. Des pans de murs tricotés ou peints servent de décoration dans les cours d’immeubles
Siècle de la publicité, des régimes totalitaires,
des armées sans clairons, ni drapeaux, ni messe pour les morts.
Je hais mon époque de toutes mes forces. L´homme y meurt de soif.
Saint-Exupéry
En cette vie il est une autre vie.
Octavio Paz
Avril 1990. Dans le train qui m´emmène à Berlin, je regarde le paysage de ce qu´il est déjà convenu d´appeler l´ex-RDA : villages noircis par la consommation de charbon dont l´odeur forte, ce printemps, traverse le couloir du wagon ; champs et forêts visiblement pollués par les fumées des usines que nous longeons, comme à Bebra, sur plusieurs kilomètres; tout un pays victime d´une politique industrielle aberrante.
Le long de la voie ferrée, les barbelés et les miradors sont les vestiges d´une guerre qui s´est achevée la veille. Et plus le train avance, plus j´ai la curieuse impression de revenir en arrière, dans ce qu´il est toutefois malaisé d´appeler une „autre époque“: Allemagne des années 50, les boutiques et les habitations n´ayant pas beaucoup changé depuis (la plupart sont délabrées et n´ont jamais été recrépites ni repeintes).
Kreuzberg, Paul Lincke Ufer. Au bord du canal, des saules aux feuilles toutes fraîches, des bâtiments bleus, beiges, blancs. Eau brune et verte du canal. C´est une rue un peu à part, presque huppée à côté des autres rues de ce quartier populaire. Maintenant que le mur s´écroule, Kreuzberg se trouve situé au centre de Berlin, alors qu´il n´était jusqu´à maintenant qu´un secteur alternatif, bien loin des avenues commerciales et du Kurfürstendamm. A certains endroits, on se croirait au milieu d´un ghetto : boutiques abandonnées, aux vitrines défoncées et pleines d´un fatras de chaises, de pots de peinture, de morceaux de plâtre et de verre. Une fille aux cheveux violets disparaît dans l´une d´entre elles, vivant sans doute dans un squatt. D´autres boutiques sont des bazars où l´on vend des transistors, des tapis, de la vaisselle, des balais, et toute sorte d´ustensiles de cuisine. Ce sont aussi des épiceries le plus souvent. Et puis beaucoup de Kneipen où l´on mange debout un kebbab ou un samoussa pour quelques marks.
Je marche de Kreuzberg jusqu´au mur, quelques centaines de mètres. Je longe celui-ci, pour la première et peut-être la dernière fois. Sensation de l´éphémère auprès de ce béton qui devait diviser Berlin encore plusieurs siècles. De nombreux graffitis ont déjà disparu. Des Mauerspechte ou „piverts de mur“ sont au travail depuis quelques mois, armés d´un burin et d´un marteau, vendant les morceaux aux touristes. Par endroits le mur est percé, ouvrant sur le Niemandsland. Immeubles et rues aussi gris que ceux de Berlin-ouest. Le gris du siècle.
Arrivé à Check Point Charlie, lieu de passage obligé entre l´Est et l´Ouest, il y a un peu partout des stands où sont exposés des morceaux du mur, morceaux de toutes les couleurs, avec parfois des bouts de verre incorporés, juste à côté d´une croix plantée à la mémoire d´un jeune homme abattu alors qu´il tentait de passer à l´Ouest. On réussit ce miracle: transformer un symbole de l´horreur et de la bêtise de ces quarante dernières années en un objet de commerce. Encore quelques mois et l´on vendra des bouts de barbelé, des pièces de mirador, et quelques morceaux d´os humains découverts sur le grand chantier à venir.
Je marche longtemps le long de cette construction absurde à moitié en ruines, je marche dans le Niemandsland, des policiers est-allemands font maintenant bonne figure, discutent tranquillement avec des passants sur lesquels ils auraient tiré il y a encore quelques mois, à ce même emplacement. Des voitures vont et viennent aux postes de contrôle ouverts depuis peu. Je ne sais si j´avance sur un immense chantier ou sur un champ de bataille.
Pour fêter la Réunification, il y aura cette mise en scène grotesque que Günter Grass a si justement dénoncée: des centaines de drapeaux nationaux flottant sur la porte de Brandebourg, une foule immense amassée autour du chancelier et du maire de Berlin, tous entonnant l´hymne national devant les caméras de toutes les chaînes du monde et au milieu des flashes photographiques: grande cérémonie carnavalo-historique pour consommateurs d´opéra politique fin de siècle et tournant à vide (qu´allez-vous faire ensemble, mes amis ?). Fête grandiose pour ceux que tout ennuie en commun (famille, travail, environnement).
Niemandsland : le pays de personne.
La ville est là
son cœur absent
entre les deux murs
à moitié abattus
quelques hommes
marchent timidement
dans le Niemandsland
eux-mêmes surpris de leur présence
vivante en ce lieu ouvert
la page est tournée
Neue Zeit, faut-il croire
à cette promesse tracée en lettres capitales
noircies avec le temps
sur un immeuble à raser ?
Fin de siècle, fin d´un monde: et, comme toujours, dans l´espoir d´autre chose. Mais il faudra bien plus que de l´espoir.
Près de Check Point Charlie, je suis entré dans une galerie de photos portant l´enseigne Wall Street Gallery (bourse de l´art ?). Y sont exposées des photos d´actualité, dont l´une d´entre elles où flambe un feu terroriste et passent des policiers de je ne sais quel pays (le cliché s´intitule „La guerre dans ma rue“), puis d´autres photos représentant des ossements et des masques collés sur le mur, ou bien, plus saisissant comme le sont toujours pour moi les reflets brisés, une quantité d´éclats de miroir reflétant des fragments des immeubles voisins, des nuages, des visages, le trottoir, des feuillages, éclats de miroir qui me font apercevoir entre deux errances le grand tableau berlinois, sans cadre ni sujet. Et c´est peut-être là, dans cette galerie et devant ce mur éclaté en mille bris de glace, que quelque chose a commencé pour moi à Berlin, au-delà du vide de l´époque.
Au musée Käthe Kollwitz, non loin de la Gedächtniskirche. Lithographies, dessins, sculptures représentant hommes, femmes et enfants du prolétariat entre 1900 et 1945 en Allemagne. Traits noirs sur fond blanc, ou pierre toujours sombre. Femme violée et peut-être morte dans un jardin. Homme ivre rentrant chez lui. Vieil homme et vieille femme assis sur un banc et le regard vidé par la fatigue, à la fin d´une vie de labeur. Révoltes ouvrières. Veillées funèbres. Soldats morts dans une tranchée. Enfants agrippés à la robe de leur mère pour obtenir du pain. En guise de titre, quelques mots de colère anticapitalistes et antifascistes. Et au milieu de ce monde de spectres historiques, des autoportraits au regard désespéré, mais exprimant toujours la résistance. Le feu noir jamais éteint de Berlin.
Il joue de son xylophone pas très loin de Unter den Linden, frénétiquement, xylophone composé de plusieurs bouteille de verre plus ou moins remplies d´eau, chaque son de la gamme claque, vif, aussi brillant cet après-midi que le verre blanc et vert des bouteilles, lui le visage calme observant des mains rapides et nerveuses.
Sur une carte postale récemment imprimée, deux hommes tapent au burin sur le mur pour en tirer quelques morceaux. A côté d´eux, déjà un peu effacé mais encore lisible, écrit en lettres capitales : NOUVEAU.
Un après-midi au marché aux puces de la station de métro Nollendorfplatz. Les stands sont installés dans d´anciens wagons. Timbres, verres, uniformes, livres (dont Aus meinem Leben, de Honecker, auquel il manque encore un chapitre !), des modèles réduits de trains, voitures, etc. Dans un machine à écrire, un heideggerien de passage a tapé : das Dasein, que l´on traduit couramment par „l´être-là“.
Après quelques journées passées dans les rues, j´erre à présent dans les musées de la ville, étouffant dans l´atmosphère de ces jours prétendument historiques, au milieu de ce spectacle déjà usé après les quelques semaines de l´automne passé. On dirait ici que les passants sont assommés, comme paralysés par le vide sur lequel s´ouvrent les bouleversements récents, et je me demande d´ailleurs si ce n´est pas le propre de l´actualité de diriger les regards vers l´absence persistante de ce qui devrait être au centre de nos vies. Berlin serait alors le sujet le plus actuel de notre époque parce qu´elle est la ville au passé rasé, au présent nul (malgré tout le brouhaha médiatique), et dont l´avenir est au fond sans surprise, malgré tout ce que racontent les journalistes et les hommes politiques, qui ne peuvent faire croire à personne que les lendemains de cette métropole, avec ses nouveaux gratte-ciels et ses centres commerciaux ultra-modernes, chanteront.
Ici, je ne vois aucun monde formé se lever, et c´est la raison pour laquelle je parcours les musées et les cultures du monde, à la recherche d´une entente de l´esprit et de la matière que toutes les ruines du présent ne peuvent promettre.
Musée égyptien:
Des hommes et des femmes jambes et torses nus portent différents mets, une chèvre sacrifiée, des vêtements, des objets usuels, jusqu´au tombeau d´un défunt –
le hérisson, l´hippopotame, le chien, le cochon, le chat, le scarabée, le lion sont aussi des dieux, loin des panthéons grecs, romains et chrétiens où l´homme seul est digne de représenter la divinité –
un sarcophage reste ouvert –
des scribes sont assis en tailleur, le stylet à la main, le corps rose et les cheveux noirs, papyrus posé à côté d´eux –
dans le sarcophage la momie –
le prêtre et sa femme se tiennent debout, bien droits, les jambes solides –
la chair noire et séchée sur le crâne, le reste du corps encore enveloppé dans les bandelettes –
quatre masques de momies maquillés d´or („chair de dieux“) et aux cheveux de laine noire –
une déesse à la tête de cochon ! rose comme les autres statues d´homme, l´air tout à la fois grave et souriante –
le roi Amenemket III regarde droit devant lui, buste à la coiffe impériale de granit gris-noir –
une barque équipée d´un grand gouvernail avance sur le Nil –
un chien, un lapin, une souris en faïence courent dans le sable –
le buste de Nefertiti –
un homme et une femme se promènent dans un jardin en dansant, séparés par une rose.
D´autres vies, d´autres formes, d´autres visages, d´autres mondes, d´autres possibilités.
Parmi les musées que je visite, il y a aussi le Dahlem Museum, où je suis retourné plusieurs fois. Arts indiens, africains, océaniens, amérindiens dont les structures et les formes toujours étonnantes et dynamiques me communiquent quelque vigueur pour retourner dehors, dans le chaos et le bruit.
Bratislava, deux ans après la chute du mur de Berlin: le centre-ville est en chantier, à l´accueil d´un hôtel une femme qui ne me salue même pas me dit qu´ici on paye en dollars – je fous le camp. Il faut que je traverse en tramway une immense zone industrielle (plusieurs usines d´automobiles dont Citroën) avant d´atteindre un camping. Le lendemain, depuis le château, j´aurai une perspective impressionnante sur la cité moderne vue par les technocrates communistes: de l´autre côté du Danube, des immeubles blancs sur des centaines et des centaines de mètres, sans aucun arbre ni jardin: des blocs de béton chus d´un désastre moderne, pour caser je ne sais quelle espèce humaine.
A l´institut français, je parle avec le bibliothécaire visiblement stressé : il m´explique qu´il doit faire attention à ce qu´on ne vole pas les livres: seule bonne nouvelle de ce périple slovaque … qu´il y ait encore des hommes pour voler des livres.
Je suis à Kwakiutl, sur la côte pacifique du Canada, au nord de Vancouver. Je découvre une série de masques très colorés, très lumineux, dans l´obscurité de la nuit. C´est le Potlach, fête rituelle indienne, et je suis invité à cette fête, après analyse sanguine qui a permis de déterminer que j´avais du sang indien, moi l´Européen, tout au fond de la cervelle. Depuis que je suis à Kwakiutl, je me suis mis, peut-être sous l´effet de l´air (et de rien d´autre !), à parler le kwakwala, sans le moindre accent français me dit-on partout dans le village (je soupçonne qu´on se moque de moi). Tous les hommes qui sont ici, d´ailleurs, sont comme moi : ils découvrent ou plutôt redécouvrent leur langue, langue qui leur a été interdit de parler pendant plusieurs générations. Et ils sont tous revenus à Kwakiutl il y a maintenant vingt ou trente ans, après des années d´existence hagarde („désorientation culturelle“ me dit l´un d´entre eux) dans les villes canadiennes. Les masques sont les vrais visages des hommes, des femmes et des enfants de cette côte. Ils sont rouges, verts, jaunes, bleus, blancs, noirs, couleurs fantastiques et naturelles à la fois. Ils sont en bois et ont les yeux grands ouverts, la peau-écorce est traversée de flammes solaires. Ils sont têtes de moustique, de loup, d´abeille, ils sont têtes d´homme et de singe, avec des barreaux couvrant leurs faces, ils sont le soleil, ils sont la lune, ils sont à la fois le soleil, la lune et le ciel nocturne, ils sont l´esprit de la forêt („hommes du sol terrestre“), ils sont têtes de corbeau, d´oiseau-tonnerre, d´aigle. Ils sont l´expression d´autres forces, d´autres vitalités, pleins de la Dugwala. Et ils sont aussi tous les êtres morts, les ancêtres au cœur de la forêt et de la terre, les insectes, les animaux souterrains, ils emmènent les hommes qui les portent dans une maison invisible où les consciences de la vie et de la mort s´associent curieusement, et ne font plus qu´une seule conscience.
J´ai porté tous les masques les uns après les autres, j´ai appris à oublier leur lourdeur, à ne plus être que le danseur rythmant son pas aux sons rapides et secs des crécelles, mille branches ou mille os que l´on casse, et j´ai été loup, feu du grand astre, l´ami fou, moustique, corbeau, et l´ami mort auquel j´ai emprunté la voix pour chanter quelques-unes de ses chansons composées sous terre, tristes, infiniment tristes. Enfin, la fête s´achevant au petit jour (tout le monde était endormi, et je me suis absenté sans réveiller personne), je me suis noyé dans un lac, j´ai senti un instant mon cœur foudroyé par la lumière du jour après de longues heures passées dans la vase aux côtés du crapaud, je suis retourné dans la mer, dansant toujours, et je me suis retrouvé au milieu d´une ronde qui n´était composée ni d´animaux, ni d´étoiles, mais de sons et de couleurs berlinoises, au milieu de la foule qui ne cessait de longer le mur ce mercredi après-midi.
La ville se fragmente
éclats d´un miroir
collés sur le mur
et renvoyant mille images
tableaux composés
de traits et de flèches
tracés dans l´urgence
où se mêlent immeubles
et wagons de métro
feu rouge orange et vert
ciel et trottoir
fenêtres, reflets
toutes les couleurs
tous les sons
bouteilles de verre
remplies selon la note
et d´où jaillissent
des sons aigus
une musique brisée
Glasmusik
coups vifs et enchaînés
des marteaux
miettes du mur
vendues à tous les coins de rue
morceaux rouges
verts et toujours noirs
la ville part en morceaux
pluie d´atomes
de sons parfois cassants
comme ceux de cette voix
hast-Du ´n paar Groschen ?
ou le frottement des roues
sur les rails du métro
taches de peinture
des mots mais peu de phrases
jokes
no future… for the wall
points d´interrogation
peu de sens
journées historiques
partant en éclats
en poussières
ou feu de forêt
avalé par Krishna
et au fond de ma cervelle
feu
coup de gong
étincelant
DÉFLAGRATION !
Dada Berlin. Sur les murs des immeubles, sur les fenêtres, sur les emplacements publicitaires, en première page des journaux, je verrais mieux des slogans dadaïstes, comme des coups de pioche de l´esprit qui veut du neuf, et pas les mêmes rengaines sur l´avenir national et je ne sais quelles autres fadaises. Un peu de feu pour brûler la pierre du mur et effacer les vieux graffitis.
Assis à un carrefour désert parce que disparu il y a quarante ans – je l´ai retrouvé á l´aide d´une vieille photo -, j´entends Johannes Baader gueuler contre l´ordre inane des choses.
Qu´est-ce qu´un dadaïste ? „Un dadaïste est un homme qui aime la vie dans ses formes les plus singulières et qui dit : je sais bien que la vie n´est pas ici seulement, mais qu´elle est aussi là, là, là (da, da, da ist das Leben) ! Par conséquent le véritable dadaïste maîtrise tout le registre des expressions vitales humaines, depuis l´autopersiflage jusqu´à la parole sacrée de la liturgie religieuse sur ce globe terrestre qui appartient à tous les hommes. Et je vais tout faire pour que des hommes vivent sur cette Terre à l´avenir. Des hommes qui soient maîtres de leur esprit et qui à l´aide de celui-ci recrééront l´humanité“.
Fondé après le groupe de Zürich animé par Tzara, le Club Dada de Berlin s´était fait connaître par ses coups d´ éclat. Raoul Hausmann, Richard Huelsenbeck, Johannes Baader et tous ceux qui gravitaient autour d´eux étaient très critiques à l´égard des sociaux-démocrates appuyés par l´armée qui avaient fondé la République de Weimar. Pour eux, qui étaient soit communistes, soit anarchistes, la domination politique, économique et culturelle de la bourgeoisie allemande désavouée par la première guerre mondiale était insupportable, et toutes les formes artistiques devaient servir avant tout à balayer la médiocrité culturelle de l´époque, et à en finir avec l´esclavage social et spirituel de l´homme moderne. L´Eglise comme l´Etat étaient dénoncés, parce qu´ils aliénaient chacun à leur manière ceux qui leur obéissaient.
Baader était devenu le spécialiste des actions de commando dirigées contre les institutions. Un jour il interrompit un sermon à la cathédrale de Berlin par un tonitruant Gott ist uns Wurscht (qu´on peut à peu près traduire par „Dieu on s´en tape !“). Un autre jour il jeta des exemplaires du Grüne Leiche (le Cadavre vert), le journal dada qu´il avait créé, en pleine séance de l´Assemblée nationale…
Ce sont des déclarations comme celles-ci qui font la force à la fois grave et grotesque de Dada Berlin :
„L´homme nouveau prononce ce discours devant ses auditeurs: cherchez un centre pour votre vie et recommencez à croire aux grandes qualités des païens. Où est votre Plutarque, qui vous apprendra ce que cela signifie de mourir pour des choses spirituelles ? Vous n´avez pas de rapport aux choses, vous laissez les petites choses de côté pour vous tourner vers les grandes montagnes fictives, et vous cherchez le paradis partout. Pourquoi ne pensez-vous pas à ce qui fait que le monde est grand et fécond ?“ (Richard Huelsenbeck)
George Grosz, Gesang an die Welt:
Ach knallige Welt, du Lunapark,
Du seliges Abnormalitätenkabinett,
Paß auf ! Hier kommt Grosz,
Der traurigste Mensch in Europa,
„Ein Phänomen an Trauer“.
Turbulence du monde !
Qu´est-ce que l´homme a inventé ?
Le vélo – l´ascenseur – la guillotine – les musées,
La variété – le frac – le musée Grévin,
La sombre Manille —
Les prisons en pierre grises
Et les parasols scintillants
Et les nuits de carnaval
Et les masques
Regardez !!! Deux singes font des claquettes au cabaret.
La criminalité augmente,
La périphérie se gondole de rire –
A ta santé, Max ! Là-haut une mouche humaine court sur des plaques de verre !!
Mouvement ! Et que ça chauffe !
L´homme masqué !!!!
Georges le Bœuf !!!!
Champion of the world !!!!
Le spectacle-éclat !!
Le murmure des billets de banque !!
Saluuuut !!!
L´assassinat de Jean Jaurès !!
L´explosion du vélodrome !!
Le sensationnel incendie du gratte-ciel !!
Le nouvel attentat des hommes du téléphone !!
Le mouvement continue.
Des milliers d´hommes meurent sans avoir vu le Gulf Stream.
J´ai écrit que les ruines du présent ne pouvaient pas présager, pour moi, un avenir quelque peu souriant. En vérité, je suis partagé. La découverte des paysages de ruines modernes, même celui que constitue pour une bonne part Berlin, m´entraine souvent dans une rêverie qui me fait sortir de l´époque et m´aide finalement à m´imaginer qu´au-delà de ces maisons effondrées, de ces murs démolis, de ces constructions monumentales rendues éphémères par la folie guerrière des hommes, s´ouvrent les voies d´un possible renouvellement. De quelle nature ? Cela reste à élucider. J´aimerais, par exemple, voir Berlin livré à la végétation et aux animaux des lacs qui sont situés à quelques kilomètres de la ville. Que l´on tarde à rebâtir me fait espérer l´apparition lente, aux milieu des décombres, d´une vie moins sauvage que celle de la foule des photographies de la Potsdamer Platz et de l´Alexander Platz. Au fond, je pressens toujours la guerre et la destruction au milieu des foules, même les plus sages. Le chiffre, la quantité sont facteurs de catastrophe inéluctable pour moi. Et j´éprouve une certaine sympathie pour les théories politico-économiques de Rousseau, qui ne peut penser un développement heureux et démocratique d´une population que sur une île montagneuse, telle la Corse, dont les obstacles naturels tiennent les groupes d´habitants les uns à l´écart des autres, en bonne entente…
Oui, le surgissement naturel d´une forêt dans les ruines berlinoises, au beau milieu du Niemandsland, me plairait, comme une image démesurément reflétée de l´arbre dans l´immeuble viennois de Hundertwasser. Il faudrait pour cela cesser de projeter un monde (cité idéale, technopole), et laisser simplement devenir les choses.
Pour le moment, le bruit et la vitesse de chacun de nos gestes, de chacune de nos paroles, désarticulent, à un degré parfois infinitésimal, le monde dans lequel nous tentons de vivre. Nos mots, nos actes les plus insignifiants blessent, défigurent, détruisent même. Le „chant au monde“ de Grosz est aussi vertigineux et catastrophique que le monde des premières techniques modernes dans lequel il surgit: il répète ou reproduit l´ensemble tumultueux de nos vies et de nos objets. La voix d´Orphée, si elle devait resurgir, serait brisée par le chaos sonore de l´époque.
Je voudrais qu´une volonté, une volonté générale, travaille les lieux, non pas une volonté de bâtir, d´emplir l´espace, mais une volonté de l´esprit et du corps d´habiter le monde dans toute son ampleur, dans toute son épaisseur, dans toute sa diversité. Avec ses courants, avec ses croissances, avec toutes ses forces, avec ses intempéries même. Volonté qui, selon moi, ferait que moins de murs soient élevés pour cacher l´horizon, et moins de constructions gigantesques échafaudées. Je rêve pourtant de bâtiments et de communautés, mais qui soient articulés à un ensemble plus vaste.
Je marche une dernière fois le long du mur dont il ne restera bientôt plus rien (certains morceaux sont transportés dans des musées – il faut bien les remplir).
Couleurs printanières du ciel, traversé par un léger vent.
Je ferme les yeux quelques instants, puis les rouvre.
Je regarde un long moment l´espace entre les deux moitiés de la ville, cet espace béant et incroyable, ce vide qui s´offre au marcheur sans destination.
Laurent MARGANTIN

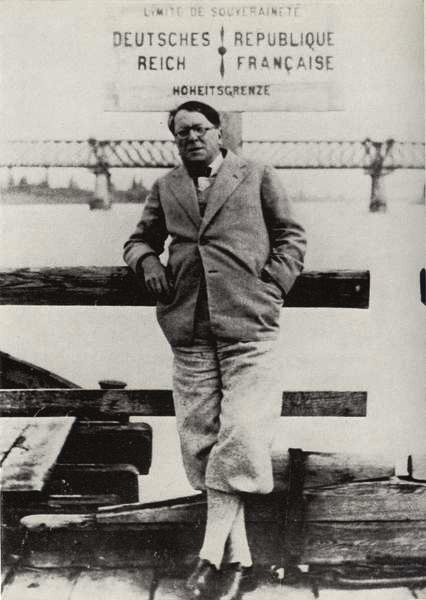

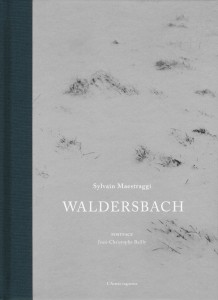

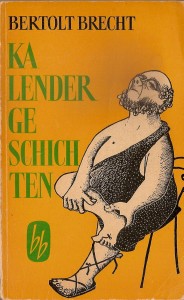
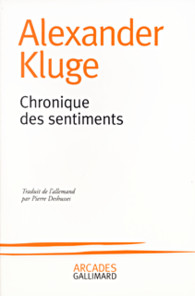
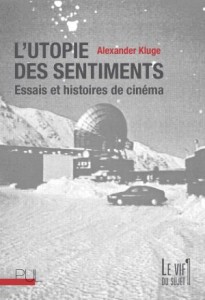
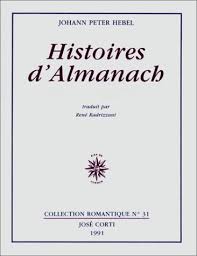

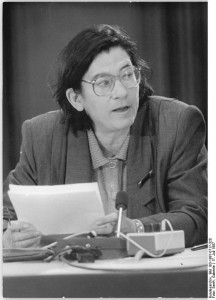
Ce que l’Allemagne doit à la Grèce et son rapport avec la réunification allemande
Deux conflits qui secouent l’Europe, en Grèce et en Ukraine, ont une partie de leur origine dans l’inachevé des accords de réunification allemande sur fond de destruction dans la pensée de la notion d’économie politique et des savoirs géopolitiques.
Émouvant extrait de Marias Miroloi (la complainte de Maria) avec la voix de Maria Labri, que l’on voit sur l’image, une survivante du massacre de Kommeno, en Grèce. Aux percussions, le musicien de jazz allemand Günter «Baby» Sommer qui signe cette composition qui fait partie du très beau CD dédié aux victimes et aux habitants de Kommeno. Maria Labri y raconte l’histoire du prêtre qui est allé à la rencontre des soldats allemands pour tenter de les dissuader de mettre à exécution leurs intentions meurtrières. Il sera tué sur le champ.
Le 16 août 1943, 317 habitants (172 femmes et 145 hommes dont 97 de moins de 15 ans et 13 bébé) ont été massacrés par une compagnie de la Wehrmacht à Kommeno, dans l’Epire au Nord Ouest de la Grèce sous le prétexte que des partisans avaient rassemblé des vivres dans le village. (J’ai raconté ici l’histoire du CD)
Kommeno comme Distomo est un équivalent d’Oradour ou de Lidice sans en avoir la portée symbolique. C’est ce que pense l’historien Hagen Fleischer, un allemand qui vit en Grèce où il est professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Athènes :
«Les massacres de Lidice en Tchéquie ou à Oradour en France ont une place dans la mémoire collective parce qu’ils font partie de la sphère culturelle de l’Europe centrale et occidentale. La Grèce dans son ensemble, les cent Lidices grecs sont une tache aveugle sur la carte européenne de la terreur nazie» (Entretien à la Tageszeitung 16 août 2013)
Il raconte une anecdote révélatrice. Lorsqu’il a, en 1970, devant une promotion d’historiens, annoncé qu’il changeait de sujet de thèse passant de l’occupation allemande du Danemark à l’occupation de la Grèce, il rencontra de l’étonnement : «quoi, nous étions là-bas aussi ?». Et comment ! En 1941, la Wehrmacht a occupé la totalité de la Grèce et de la Crète après que l’Italie de Mussolini n’ait pas réussi à venir à bout de la résistance grecque. L’occupation a fait entre 300 et 600.000 victimes. Une centaine de milliers de civils sont morts de faim. 60 000 juifs en grand partie de Salonique, la Jérusalem des Balkans, ont été déportés et assassinés.
L’occupation de la Grèce signifiait aussi son exploitation économique. Il s’agissait de faire financer l’occupation par l’occupé. L’Allemagne nazie n’a pas seulement prélevé des matières premières et des productions. Au centre de la controverse actuelle se trouve la question d’un crédit extorqué qui, en 1945, s’élevait au total à 476 millions de Reichsmarks et n’a jamais été remboursé.
Cette dette relève-t-elle d’un contrat de crédit ou entre-t-il dans la catégories des dommages de guerre ayant fait l’objet de réparations ? Même si nous sommes dans un cas limite comme certains le pensent, seule la Cour de justice internationale pourrait trancher. Elle n’a pas été saisie. Il est parfaitement légitime de la part du gouvernement grec de laisser cette question ouverte à la négociation bilatérale. Si elle a été relancée par Alexis Tsipras dans sa déclaration gouvernementale et confirmée récemment, la revendication de la Grèce est ancienne et ne date pas de l’arrivée au pouvoir de Syriza. Le gouvernement allemand considère que la question des réparations est définitivement close, un point de vue contesté en Allemagne même, à la fois sur le plan juridique mais plus encore sur le plan moral. Alors qu’était remise sur le tapis la question de la saisie, pour réparations, de biens allemands, saisie autorisée par un tribunal grec, dans un discours au Parlement, le 11 mars, le Premier ministre grec, après avoir accusé l’Allemagne de «tours de passe passe juridiques» a déclaré : «je voudrais personnellement assurer aux deux peuples, aussi bien aux Grecs qu’aux Allemands que nous approcherons la question avec la sensibilité, la responsabilité et l’honnêteté requises dans la communication et le dialogue». Peut-être un appel au calme à ses compatriotes. Cependant, certaines déclarations ministérielles intempestives ne facilitent pas la compréhension.
En 1946, la Conférence de Paris sur les réparations de guerre fait une répartition en matériel et en liquidités sans proportion avec les dommages réellement subis par la Grèce qui n’en perçoit que 25 millions de dollars. Peanuts pourrait-on dire alors qu’il est admis que la Grèce fait partie des pays qui ont le plus souffert du nazisme.
En 1953, les accords de Londres sur la dette – au demeurant signés par la Grèce – procèdent à l’effacement d’une partie de la dette de guerre allemande. Il est à noter qu’un tel effacement était déjà intervenu sur les réparations de la Première guerre mondiale :
« après un premier moratoire sur le paiement de sa dette en 1922, l’Allemagne fit défaut en 1923. Sous la houlette des Etats-Unis, on envisagea alors deux rééchelonnements. Le premier, associé au plan Dawes de 1923, se traduisit par une diminution des annuités et par le lancement d’un emprunt avec l’émission de titres à maturité de vingt-cinq ans.
Mais l’échec du plan Dawes conduisit à un deuxième rééchelonnement, le plan Young de 1930 : les paiements furent rééchelonnés sur cinquante-neuf ans, et un nouvel emprunt international fut lancé avec émission de titres ayant une maturité de trente ans. Ces plans ambitieux n’empêchèrent pas l’Allemagne d’accumuler des arriérés de paiement à partir de 1933, date à laquelle le régime nazi décide de refuser tout remboursement de ses dettes ».
(Gilles Dufrénot : La dette grecque de 2015 comme la dette allemande de 1953 in Le Monde 03.02.2015
Avec les accords de Londres, sur les 29,7 milliards de Deutsche Marks dus en réparations de la Seconde guerre mondiale, il n’en restait plus que 14 remboursables, pour partie sur 20 ans, pour partie sur 30. Cela a permis le réarmement de l’Allemagne souhaité par les États-Unis alors qu’ils s’engageaient dans la guerre de Corée.
Surtout, l’accord renvoyait toutes les autres questions en suspend aux … calendes grecques, c’est à dire, pensait-on, à une hypothétique réunification allemande à laquelle personne ne croyait à l’époque (et que d’ailleurs personne ne souhaitait).
Il y avait notamment en suspend la question d’un prêt forcé. Concrètement comme l’explique Hagen Fleischer dans un entretien à la Tagesschau (10.02.2015), «de mars 1942 à Octobre 1944, la banque nationale grecque [sous l’autorité d’un gouvernement de collaboration] devait chaque mois – souvent plusieurs fois – créditer un compte de la Wehrmacht [l’armée allemande] de sommes importantes» Certaines d’entre elles ont été remboursées. Un remboursement certes sans intérêt était en effet prévu, confirmant qu’il s’agissait bien d’un crédit. «Ce crédit d’occupation est un cas singulier, on ne peut le comparer aux dettes de guerre allemandes dans d’autres pays, assure encore Fleischer qui a trouvé dans des archives fédérales un memorandum dans lequel les experts du régime nazi ont eux-mêmes évalué le montant de la dette du Reich envers la Grèce à 476 millions de Reichsmarks. Il a également déniché dans les archives de la banque nationale grecque un calcul qui a la même époque arrive à peu près au même résultat : 228 millions de dollars ( 2 Reichsmarks de l’époque valaient 1 dollar). Avec les intérêts sur 70 années, on arrive à une estimation de l’ordre de 11 milliards d’euros. Vu ainsi, on le voit, cette question ne relèverait pas des réparations de guerre stricto sensu mais d’une somme due par contrat et jamais remboursée.
En 1953, les questions en suspend avaient été reportées mais pas du tout considérées comme réglées ou annulées. Et la réunification allemande à laquelle on ne croyait pas a eu lieu en 1990. Toute l’argumentation du gouvernement allemand repose aujourd’hui sur le fait que l’accord dit 2+4 mettant fin à la division de l’Allemagne équivaut à un traité de paix et solde les comptes avec la Grèce comme avec tous les autres. L’accord 2+4 a été signé par les deux Allemagnes, ainsi que par France, la Grande Bretagne, les États-Unis et l’Union soviétique d’où son nom. Il entérine la fin de la guerre froide et permet à l’Allemagne de retrouver sa pleine souveraineté avec le retrait des troupes alliées.
Et c’est précisément pour ne pas prendre le risque que d’autres pays aient la possibilité de faire valoir des questions en suspend qu’on a réduit l’accord aux 2+4 en le faisant passer pour un traité de paix. Un traité de paix à 5 ?!
« Le gouvernement allemand a conclu cet accord avec l’idée qu’il réglait définitivement la question des réparations. L’accord 2+4 ne prévoit pas d’autres réparations » (Karl Diller, Secrétaire d’état aux relations avec le parlement auprès du Ministre des finances, 30 janvier 2003)
Dans ses Mémoires, l’ancien ministre des Affaires étrangères à la manœuvre à l’époque [avec Roland Dumas, côté français], Hans Dietrich Genscher, note qu’avec la signature de l’accord 2+4, «on ne pouvait plus réclamer un traité de paix et nous avons ainsi été soulagé du souci de demandes de réparations imprévisibles».
L’accord a été soumis aux pays (dont la Grèce) participants du processus d’Helsinki (Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe) qui déclarent en avoir pris «connaissance avec satisfaction». Pour le gouvernement allemand, «prendre connaissance» signifie signer un traité de paix ! Selon un rapport d’expertise du Bundestag, il n’est pas établi juridiquement que prendre connaissance fut-ce avec satisfaction signifie renoncer explicitement à toute revendication de réparations et moins encore au remboursement d’un crédit que n’en relève pas à proprement parler.
L’hebdomadaire Der Spiegel est récemment revenu sur la question affirmant avoir revisité les documents pour montrer comment Helmut Kohl, le chancelier de l’époque et son Ministre des Affaires étrangères ont fait des pieds et des mains pour empêcher que la question des réparations n’affleurent et pour maintenir à l’écart des pays comme la Grèce. Les Soviétiques s’y sont laissés prendre – ils attendaient surtout de l’Allemagne une aide économique et financière – et la France de François Mitterrand n’a rien trouvé à y redire.
Le Spiegel écrit :
« Un ministre grec déclara plus tard que le successeur d’Adenauer, Ludwig Erhard lui avait promis qu’on rembourserait le crédit forcé une fois l’Allemagne réunifiée. Selon le gouvernement fédéral une telle déclaration ne se retrouve dans aucun document officiel. Toutefois, elle correspondrait à la logique de l’accord de Londres sur la dette ; et lorsque, en 1989, le Mur est tombé, on vit aussitôt apparaître en Grèce des revendications de réparations » (Spiegel 9/2015 Die Furcht vor dem F-Wort).
Autrement dit en résumé, dans un premier temps alors qu’on n’y croyait pas la réunification allemande a servi à repousser les demandes de réparations et une fois la réunification acquise tout a été fait pour empêcher qu’elles n’affleurent. Il paraît que c’est ce que l’on appelle un «chef d’œuvre de diplomatie».
Cela montre aussi que lorsqu’il s’agit de leurs intérêts, les Allemands savent jouer avec le temps (la Grèce ne réclame rien d’autre) et que la dette n’est pas pour eux une question morale. La soi-disant morale du remboursement ne sert qu’à l‘inversion des causalités – c’est ainsi que Bernard Stiegler définit l’idéologie. Ce que la Troïka veut surtout, après avoir renfloué les banques allemandes et française en faisant passer cela pour une aide à la Grèce, c’est imposer le dogme TINA, There is no alternative à la politique ultra libérale plus connue sous le nom de réformes et montrer qu’on ne peut en sortir. Quand au désespoir que cela peut provoquer, personne n’en est bien sûr jamais responsable.
La réunification allemande et l’Ukraine
Je voudrais maintenant élargir mon propos à un autre conflit qui tire lui-aussi en partie sa source de l’inachevé des accords de réunification allemande, il s’agit de l’Ukraine. Il y avait en effet dans ce processus un implicite qui n’a jamais été codifié. Il concerne la non extension de l’Otan vers l’Est, promesse faite à Mikhaïl Gorbatchev qui croyait à la Maison commune Europe. En 1997, encore, Madeleine Albright, Secrétaire d’état de Bill Clinton déclarait à Moscou devant Boris Eltsin : « Plus jamais vous contre nous et nous contre vous mais tous ensemble du même côté, telle est la philosophie de l’Otan ». Ce sont restées paroles en l’air.
«Mikhaïl Gorbatchev avait donné son accord à la participation de l’Allemagne réunifiée à l’OTAN à la condition que l’OTAN ne s’étendrait pas plus loin à l’est. Des représentants de haut rang comme James Baker et Hans-Dietrich Genscher ont publiquement donné leur assentiment [mais il n’y a pas d’engagement écrit]. A l’époque, l’OTAN comptait 16 membres. Après les élargissements de 1999, 2004 et 2008 elle en a 28 parmi lesquels six anciens alliés et 3 anciennes républiques soviétiques» ( Reinhard Mutz : Die Krimkrise und der Wortbruch des Westens (La crise de Crimée et le déni de parole de l’ouest) in Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2014)
En 2008, il a été question de l’adhésion de la Géorgie et de l’Ukraine. Faut-il chercher beaucoup plus loin…? Même si le comportement vulgaire et autocratique des dirigeants russes et l’annexion illégale de la Crimée rendent l’analyse difficile, certaines données géopolitiques sont difficilement contournables.
«De la fin de la division [de l’Allemagne] devait sortir un nouvel ordre de paix et de sécurité solide de Vancouver à Vladivostok comme cela avait été convenu dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe [celle-là même où des pays prenaient connaissances de l’accord 2+4] signée en novembre 1990 par 35 chefs d’État et de gouvernement de la Conférence pour la paix et la sécurité en Europe. Sur la base des principes définis et des premières mesures concrètes devait être construite une « Maison européenne commune » dans laquelle chaque état participant bénéficierait d’une égale sécurité. Cet objectif politique de l’après guerre n’a pas été tenu».
Le passage est extrait d’un texte intitulé «Wieder Krieg in Europa ? Nicht in unserem Namen !»(De nouveau la guerre en Europe ? Pas en notre nom !) signé par plus d’une soixantaine de personnalités parmi lesquelles on relève l’ancien président de la République Roman Herzog, Antje Vollmer, l’ancien chancelier Gerhard Schröder mais aussi Wim Wenders, Hanna Schygulla, Christoph Hein, Ingo Schulze, Gerhard Wolf etc.. (Source)
Pour les signataires, l’extension de l’ouest vers l’est, perçue comme menaçante par la Russie n’aurait pas dû se faire sans «en même temps approfondir la coopération avec Moscou».
La destruction des savoir géopolitiques
Les deux conflits qui n’ont rien de marginaux ont pour arrière plan la destruction pour l’un, la Grèce, de la notion même d’économie politique et l’autre, l’Ukraine, celle des savoirs géopolitiques. Dans les deux cas l’Allemagne se trouve au centre du jeu. Dispose-t-elle – et avec elle l’Europe – d’une conception géopolitique ?
La géopolitique est une notion qui particulièrement en Allemagne a été discréditées à la fin de la seconde guerre mondiale. Et, à la suite, les réalités mondiales étaient toutes lues dans l’optique du conflit est-ouest, explique Herfried Münkler, politologue et historien des idées. Mais il ajoute :
«Cela s’est modifié entre 1989 et 1991, avec l’effondrement du Pacte de Varsovie puis l’éclatement de l’Union soviétique mais on ne l’a pas remarqué. Occupés par les conséquences économiques et sociales de la réunification, nous n’avons pas vu la signification de la renaissance d’un centre européen dans la perception de ses voisins comme pour l’action de l’Europe unie sur ses marges. Avec la crise de l’euro, le conflit Russie-Ukraine et l’effondrement de l’ordre politique au Proche Orient avec la guerre des milices de l’état islamique, la géopolitique a fait retour dans l’agenda politique. Elle s’est heurtée à une pensée politique qui n’était pas préparée au retour des fantômes du passé»
Or l’Europe n’a pas de volonté d’autonomie, aucune conception de son devenir, n’a pas de concept géopolitique, il est question bien sûr d’une géopolitique de l’ère des drones à reconstruire et non de celle du siècle dernier.
«Les Européens ne pourront pas à moyen terme s’abstenir de définir leur positionnement géopolitique. Et les Allemands devront comprendre qu’ils ont en tant que puissance du centre de l’Europe une responsabilité particulière pour l’avenir de l’Union européenne : ils doivent agir contre les forces centrifuges pour maintenir ensemble le sud et le centre de l’Europe mais aussi l’est et l’ouest. Pas d’extension, de la cohésion, tel serait la notion géopolitique clé de son action. La tâche politique centrale de l’Allemagne fédérale dans les prochaines années serait de transformer les forces centrifuges en dynamiques centripètes. Cela ne se fera pas sans une formation géopolitique de la pensée ».
(Herfried Münkler : Vom Nutzen und Nachteil geopolitischen Denkens (Avantages et inconvénients d’une pensée géopolitique)