En 1923, soit plus d’un siècle après son écriture probable au début des années 1790, Franz Zinkernagel révélait un texte inachevé du poète allemand Friedrich Hölderlin. Il portait le titre Communismus des Geister, communisme des esprits. Sans m’attarder sur les débats portant sur l’authenticité du texte et surtout du titre, il m’a semblé plus intéressant d’aller creuser dans l’œuvre pour voir ce qu’elle contenait pouvant correspondre à cette expression. Une bien intéressante (re)lecture.
COMMUNISMUS DER GEISTER
Theohaid und Oskar Eugen und Lothar
Disposition
Sonnenuntergang. Kapelle. Weites, reiches Land. Fluss. Wälder. Die Freunde. Die Kapelle allein noch beleuchtet. Das Gespräch kommt auf das Mittelalter. Die Mönchsorden nach ihrer idealen Bedeutung. Ihr Einfluss auf die Religion und zugleich auf die Wissenschaft. Diese beiden Richtungen sind auseinander gegangen, die Orden gefallen, wären aber nicht ähnliche Institute zu wünschen ? Wir gehen eben Vom entgegengesezten Princip aus, von der Allgemeinheit des Unglaubens, um ihre Notwendigkeit für unsre Zeit zu beweisen. Dieser Unglaube hängt mit der wissenschaftlichen Kritik unsrer Zeiten zusammen, welche der positiven Spekulation vorausgeeilt ist, darüber lässt sich nicht mehr klagen, es handelt sich drum, zu helfen. Entweder muss die Wissenschaft das Christentum vernichten oder mit ihm eins seyn, da die Wahrheit nur eine seyn kann, es handelte sich also drum, die Wissenschaft nicht Von äusserlichen Umständen abhängig Werden zu lassen und im Vertrauen auf jene Einheit, die Jeder, der die Menschheit kennt und liebt, wünscht und ahnt, ihr eine grossartige, würdige, selbständige Existenz zu schaffen. Seminare und Akademieen unserer Zeit. Universitäten. Die Neue Akademie.
(Ausführungsversuch)
Ein schöner Abend neigte sich zu seinem Ende. Das scheidende Licht schien alle seine Kräfte noch zusammenzuraffen und warf die letzten goldenen Strahlen über eine Kapelle, die auf der Spize eines mit Wiesen und Wein bewachsenen Hügels in reizender Einfalt sich erhob. Das Thal am Fusse des Hügels war nicht mehr berührt vom Schimmer des Lichts und nur die rauschende Wooge gab Kunde vom nahen Nekar, der, je mehr die Melodie des Tags verhallte, um so lauter seine murmelnde Stimme erhob, die kommende Nacht zu grüssen. Die Heerden waren heimgezogen und nur selten schlich ein schüchternes Wild aus dem Walde hervor, sich unter freiem Himmel seine Nahrung zu holen. Das Gebirge war noch erleuchtet. Ein Geist der Ruhe und Wehmuth war über das Ganze ausgegossen.
„Lothar », so begann der Eine Von zwei Jünglingen, die von der Staffel der Kapelle aus längere Zeit diese Scene betrachtet hatten, und nun von ihrem Orte etwas gewichen waren, um dem lezten Strahl, der das Dach der Kirche traf, Lebewohl zu sagen, „Lothar! Erfasst dich nicht auch ein geheimer Schmerz, wenn das Auge des Himmels aus der Natur genommen ist und so die Weite Erde da liegt, wie ein Räthsel, dem das Wort der Lösung fehlt, siehe, nun ist das Licht dahingegangen und schon hüllen sich auch die stolzen Berge in’s Dunkel, diese Bewegungslosigkeit ängstigt und die Erinnerung an die vergangne Schönheit wird zum Gift, es ist mir hundertmal ebenso gegangen, Wenn ich aus dem freien Aether des Altertums zurükkehren musste in die Nacht der Gegenwart, und ich fand keine Rettung, als in starrer Ergebung, die der Tod der Seele ist ; es ist ein peinigendes Gefühl um die Erinnerung verschwundner Grösse, man steht, wie ein Verbrecher, vor der Geschichte, und je tiefer man sie durchlebt hat, um so heftiger erschüttert Einen das Erwachen aus diesem Traum, man sieht eine Kluft zwischen hier und dort, und ich wenigstens muss so vieles, was doch schön und gross war, verloren geben, Verloren auf immer. Sieh’ diese Kapelle an; was war es für ein kolossaler, kraftvoller Geist, der sie erschuf, mit Welcher Macht zwang er die weite Welt, den stillen Hügel krönte er mit dem friedlichen Heiligtum, in die Ebene des Thals stellte er sein Kloster und in’s Gewühl der Stadt den majestätischen Dom und tausende von Menschen waren ihm unterthan und zogen im härenen Kleid arm und verlassen vom Zärtlichsten, was die Erde giebt, umher als seine Apostel und wirkten – doch ich brauche dir nicht zu erzählen, du kennst die Weltgeschichte; und wo ist des Alles? Du verstehst mich, ich frage nicht nach dem, was uns jenes Zeitalter überliefert hat, ich frage nicht nach dem todten Stoffe, sondern, wenn du so willst, nach der Form, in der es geschah, nach jener Energie und Consequenz, die sich in’s Unendliche zu Verlieren schien und dennoch auch in das Entfernteste die Übereinstimmung mit dem Mittelpunt trug, die in jeder Variation den Klang der ursprünglichen Melodie festhielt ; die Form in diesem Sinne ist ja das Einzige, was für uns in unsern Verhältnissen einen Vergleichungspunct darbieten kann, da der Stoff immer etwas Gegebenes ist; die Form aber ist das Element des menschlichen Geistes, in welchem die Freiheit als Gesez wirkt und die Vernunft gegenwärtig wird; nun vergleiche aber jene Zeit und unsere, wo willst du eine Gemeinschaft finden? wo ist die Brüke, die so vieles Herrliche aus jenem Lande zu uns trüge? Wo ist jener fromme, gewaltige Geist, der die Kirchen erbaut, die Orden gegründet hat. Alles, wie aus einem Gusse? der von einem Mittelpuncte, Welcher über die damalige Welt sich erhob, Alles unter seine Intelligenz und Glaubenskraft niederzwang?
[Disposition zu einem Aufsatz]
Es koncentrirt sich bei uns alles auf’s Geistige, wir sind arm geworden, um reich zu werden.
[…]
Johann Christian Friedrich Holderlin : Communismus der Geister in Franz Zinkernagel : Neue Hölderlinfunde Neue Schweizer Rundschau (1924)
Communisme des esprits
Eugène et Lothaire Thibaut et Oscar
ESQUISSE
Coucher de soleil. Chapelle. Une contrée vaste et riche. Fleuve. Forêts. Les amis. Seule la chapelle est encore dans la lumière. On en vient à parler du Moyen Âge. Les ordres monastiques considérés dans leur signification idéale. Leur influence sur la religion et, en même temps, sur la science. Ces deux orientations se sont séparées, les ordres religieux se sont effondrés, mais est-ce que des institutions du même genre ne seraient pas souhaitables ? Afin de démontrer leur nécessité pour notre temps, nous partons précisément du principe opposé, de la généralisation de l’incrédulité. Cette incrédulité se rattache à la critique scientifique contemporaine, qui a pris de l’avance sur la spéculation positive. Rien ne sert de se lamenter à ce propos, il s’agit de faire quelque chose. Il faut, ou bien que la science anéantisse le christianisme, ou bien qu’elle ne fasse qu’un avec lui, car il ne peut y avoir qu’une seule vérité. Il s’agirait donc de ne pas laisser la science tomber dans la dépendance de circonstances extérieures, et, confiant en cette unité que souhaitent et que pressentent tous ceux qui connaissent et qui aiment l’humanité, de lui ménager une existence indépendante, digne et majestueuse. Séminaires et académies de notre temps. La Nouvelle Académie.
« Lothaire » — ainsi commença l’un des deux jeunes gens qui, du parvis de la chapelle, avaient contemplé ce spectacle pendant un certain temps, et qui, maintenant, s’étaient un peu éloignés de cet endroit pour dire adieu au dernier rayon du soleil qui touchait le toit de l’église — « Lothaire ! Est-ce que tu ne te sens pas étreint, toi aussi, par une douleur secrète quand l’œil du ciel est ainsi enlevé à la nature, et qu’alors la vaste terre se trouve là comme une énigme dont il manque le mot ? Voici que la lumière s’en est allée et déjà les fières montagnes s’enveloppent d’ombre, elles aussi. Cette absence de mouvement suscite l’angoisse, et le souvenir de la beauté passée devient comme du fiel. J’ai éprouvé cela des centaines de fois, lorsqu’il me fallait quitter le libre éther de l’Antiquité pour revenir à la nuit du présent : je ne trouvais de salut que dans la résignation, qui est la mort de l’âme. Il y a un sentiment qui vous torture, au souvenir de la grandeur disparue, et on est là comme un criminel, devant l’histoire. Plus on a revécu celle-ci profondément, plus on est violemment bouleversé en s’éveillant de ce rêve : on voit un abîme entre ici et là-bas, et moi, du moins, toutes ces choses qui furent si belles et si grandes, je suis obligé de les tenir pour perdues, pour perdues à jamais. Regarde cette chapelle : comme il était formidablement puissant l’esprit qui la créa, avec quelle force il dompta le vaste monde ! Il couronna la colline paisible avec ce sanctuaire pacifique, dans la vallée il installa son monastère, et dans le tumulte de la ville il édifia sa majestueuse cathédrale. Des milliers d’hommes lui étaient soumis et, apôtres de cet esprit, ils allaient çà et là, vêtus de cilices, pauvres, privés de ce que la terre produit de plus délicat, et ils agissaient. Mais je n’ai pas besoin de te raconter tout cela, tu connais l’histoire du monde. Et qu’est-il advenu de tout cela ? Comprends-moi bien : la question ne concerne pas ce que ce siècle-là nous a transmis. Ma question ne concerne pas le matériau mort, mais plutôt, si tu veux, la forme dans laquelle cela s’est produit, cette énergie et cet esprit de cohérence qui semblaient se perdre dans l’infini et qui pourtant savaient mettre en accord avec le centre ce qui paraissait même le plus éloigné, et maintenait fermement dans chaque variation le ton de la mélodie originaire. La forme, prise en ce sens, est sans doute la seule chose qui, dans notre situation, puisse nous fournir un point de comparaison, car le matériau n’est jamais que quelque chose de donné. Mais la forme est l’élément de l’esprit humain, c’est la liberté qui y opère comme loi, et la raison s’y actualise. Et alors, compare donc ce temps-là avec le nôtre : où trouveras-tu une communauté ? Où est le pont qui nous permettrait de recevoir, de ce pays lointain, tant de choses magnifiques ? Où est passé cet esprit pieux et puissant qui a construit les églises, fondé les ordres religieux, et tout cela comme d’une seule coulée ? Cet esprit qui, d’un point central, s’éleva au-dessus du monde de cette époque et qui soumit tout à son intelligence et à la force de sa foi ?
ESQUISSE
Chez nous, tout se concentre dans le spirituel, nous sommes devenus pauvres pour devenir riches.
[…]
Johann Christian Friedrich Holderlin : Communisme des esprits. Traduction J. D’Hondt Cahier de l’Herne Hölderlin)
Ce texte a donc été déniché et publié en 1923 par l’historien de la littérature Franz Zinkernagel dans la Neue Schweizer Rundschau sous le titre Neue Hölderlin-Funde (Nouvelles découvertes hölderliniennes). Il ne donne guère de détails si ce n’est pour rappeler le grand projet éducatif que Hölderlin partageait avec Hegel et Schelling. Franz Zinkernagel avait par ailleurs identifié la chapelle comme étant la chapelle Saint Rémi de Wurmlingen située à environ une heure de Tübingen.
Ce qui m’a tout de suite frappé à la première lecture du texte, outre le caractère percutant du titre Communismus -avec un C – der Geister (Communisme des esprits) sur lequel je reviendrai plus loin, c’est le rapport qui est établi entre les ordres monastiques qui, un jour florissants, se sont effondrées et la nécessité d’une nouvelle académie. La nouvelle relation entre sciences et religion à l’époque de l’Idéalisme allemand avait généralisé l’incrédulité.
Le texte français a été établi par Jacques D’Hondt pour les Cahiers de l’Herne (1989). Il l’a commenté sous le titre Le meurtre de l’histoire.(Accessible en ligne). La question a été récemment relancée par l’universitaire américain Joseph Albernaz dans un article (en anglais) de la Germanic Review relayé par Frédéric Neyrat qui a partiellement traduit en français l’introduction et le commente lui-même.
J. D’Hondt a examiné et discuté la controverse qui oppose partisans et adversaires de l’authenticité hölderlinienne du texte. Je vous y renvoie et retiens qu’en tout état de cause, « il y a du Hölderlin dans ce texte ». Il date de l’époque où les condisciples du Stift de Tübingen Hegel, Hölderlin et Schelling concevaient des textes ensemble.
« Hegel, Hölderlin, Schelling et leurs amis se souciaient peu, dans leur jeunesse, de déterminer la part qui revenait à chacun dans l’élaboration d’une pensée nouvelle, qu’ils voulaient universelle. Ils travaillaient en commun, élaboraient en commun leurs projets, leurs essais, ne distinguaient pas le « mien » du «tien». Ce désintéressement ne durera pas, ou deviendra affectation. Il caractérise une période de formation, alors que chacun d’entre eux ne s’est pas encore véritablement trouvé. Il concerne des écrits qui ne manquent certes pas pour autant d’intérêt. En lui se manifeste déjà discrètement une des formes d’un « communisme des esprits» qui ira jusqu’à l’anonymat des œuvres. »
(Jacques D’Hondt : Le meurtre de l’histoire in Cahiers de l’Herne. 1989).
Reste la question du titre. A-t-il été ajouté plus tard ? Cela n’importe que sur un point. S’il est d’origine, ce serait alors la première utilisation du mot communismus. Il serait qui plus est issu d’une conversation entre un philosophe et un poète allemands. En 1841 encore, Heinrich Heine écrivait communismus avec un C. Jusqu’à présent, l’on considérait que le mot a été écrit pour la première fois par Restif de la Bretonne dans Monsieur Nicolas en 1796-97. Il utilise le mot communisme au sens de
« mettre en commun, dans chaque cité, toute la surface de la terre pour être cultivée»
ainsi que
« tous les produits, tant des champs, des vignes, des prairies, des bestiaux de toute espèce ; que les produits des metiers, des arts et des sciences : Desorte que Tout le monde travaillât, come On travaille aujourd’hui et que Chaqu’un profitât du travail de Tous ; Tous du travail de Chaqu’un. A mettre de même en commun les maisons […] les Enfants….».
(Nicolas-Edmé Restif de la Bretonne : Monsieur Nicolas ; ou le Coeur-Humain dévoilé. Tome 8. Cité dans le livre de Jacques Granjonc : Communisme/ Kommunismus / communism. Origine et développement international de la terminologie communautaire prémarxiste des utopistes aux néo-babouvistes. 1785-1842. Editions des Malassis. pp.371-372)
Le mot communiste, lui, est bien plus ancien. Il est attesté dès le XIIème siècle. Pour faire court, la première trace écrite en français date de 1706 où l’expression un « bon communiste » désigne celui qui a le sens de l’intérêt commun. J. Granjonc évacue résolument le titre comme inauthentique. Exit Hölderlin. Peu importe ! L’expression reste en tout état de cause intéressante. Mais surtout, et c’est plus ennuyeux, la rejeter empêche d’aller voir ce qui dans l’œuvre du poète pourrait y correspondre. S’il n’y en avait rien du tout, le problème serait résolu. Or, ce n’est pas le cas, bien au contraire, comme nous le verrons. Enfin, par delà la question de savoir qui l’a écrit le premier, celle qui importe est de constater que le mot communisme commence à faire flores au moment de la Révolution française qui est au centre des préoccupations de Hölderlin. Et il circulait peut-être déjà avant qu’un auteur ne le consigne par écrit.
Tout commence par une promenade avec Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Chapelle Saint Rémi à Wurmlingen. Photo Thomas Hentrich,
Le 16 novembre 1790, Hölderlin écrit à sa sœur :
„Heute haben wir großen Markttag. Ich werde, statt mich von dem Getümmel hinüber und herüberschieben zu lassen, einen Spaziergang mit Hegel, der auf meiner Stube ist, auf die Wurmlinger Kapelle machen wo die berümte schöne Aussicht ist“.
« Aujourd’hui, c’est la grande foire. Au lieu de me faire bousculer de droite et de gauche par la cohue, je vais faire avec Hegel, qui est chez moi, une promenade à la chapelle de Würmlingen d’où l’on a une vue renommée pour sa beauté »
(Hölderlin : Œuvres. Pleiade. Pp 64-65)
Nous savons donc que deux des personnages du récit sont Hegel et Hölderlin et que le texte devrait se situer après cette promenade en novembre 1790. Certains auteurs le date de 1793, d’autres de 1794. Il est composé de trois parties : une disposition, un essai de développement, quelques notes que je n’ai pas reprises.
De quoi Hegel et Hölderlin ont-ils parlé ? De l’effondrement des ordres monastiques et de la nécessité de concevoir de nouvelles institutions académiques prenant acte du changement d’époque dans laquelle ils vivent. Sans nostalgie du Moyen-Âge, ils tentent de retrouver l’énergie qui a conféré une puissance aux bâtisseurs de cathédrales dans un contexte de « généralisation de la mécréance » (Allgemeinheit des Unglaubens, [Unglaube = incrédulité, perte de foi]). Quel pont peut-on jeter entre cette lumière finissante qui éclaire encore le passé (la chapelle) dans la nuit du présent et un avenir ? Où pour cela trouver une communauté ?
Avec le nouvel « esprit du capitalisme », analysé par Max Weber, les affaires séculières du négotium, la préoccupation de la subsistance qui s’exprime par la cohue de la foire dans la lettre du poète à sa soeur, allait grignoter l’otium, qui ,« comme soin, cura, […] consiste en pratiques libres de tout souci de subsister, libres de tout negotium », comme l’écrit Bernard Stiegler. L’esprit du capitalisme est un changement de sens du désir de s’élever : il devient une « éthique de la besogne » (Stiegler), c’est-à- dire du negotium. Hölderlin était proche de cela quand il parlait de « s’élever au dessus de la simple satisfation de ses besoins élémentaires » pour trouver une vie supérieure.
Selon Weber, cette mutation dans l’esprit religieux conduit à une rationalisation qui finit par s’opposer à cet esprit religieux comme croyance. Celle-ci se transforme en crédit obtenu par la confiance. Celle-ci relève du calculable et mesure le temps de l’occupation (negotium). Cela se traduit chez Benjamin Franklin par ce premier commandement que « le temps est de l’argent » — ce qui signifie d’abord que le service à Dieu devient calculable et rationnel. Et qu’il est immoral de gaspiller du temps hors du labeur. Cet « esprit du capitalisme » menace l’esprit lui-même. On peut parler aujourd’hui de l’esprit perdu du capitalisme.
Hölderlin parle de « ce pauvre commerce où l’esprit solitaire compte et recompte l’argent amassé » (Hypérion p.13). Et dans la fameuse diatribe contre les Allemands, il écrit :
« Il n’est rien de sacré que ce peuple n’ait profané [entheiligt=désacralisé], rabaissé au niveau d’un misérable expédient ; et ce qui, même chez les sauvages, se maintient ordinairement dans sa pureté divine, ces barbares du tout calculable (allberechnenden Barbaren) le traitent comme s’il s’agissait de n’importe quel métier. Et ils ne peuvent faire autrement car une fois que l’être humain a subi un pareil dressage il ne voit plus que son objectif, son profit, il cesse de s’exalter, Dieu, l’en garde ! Cela reste ancré en lui (es bleibt gesetzt). Et quand c’est férié, quand c’est fête (wenn es feiert), quand il aime, quand il prie, et même quand se déploie la fête gracieuse du printemps, quand l’heure de la réconciliation du monde chasse tous les soucis, quand l’innocence s’instille par magie dans un cœur coupable, quand dans l’ivresse de chauds rayons de soleil, l’esclave oublie joyeusement ses chaînes et que les ennemis de l’humain, radoucis par l’air divin, sont aussi pacifiques que des enfants… quand même la chenille s’aile et que l’abeille essaime, l’Allemand reste rivé à sa tâche, fort peu soucieux du temps qu’il fait ».
(Hölderlin : Hypérion. Trad. Philippe Jaccottet. Nrf Gallimard. 1973. p.234. Traduction légèrement modifiée)
Le service divin est traité comme n’importe quel métier. C’est aussi ce qu’Empédocle reprochera à la « clique» des prêtres. La barbarie du tout calculable consiste à jauger toutes les activités humaines y compris celles de l’esprit à l’aune de ratios comptables. Elle provoque la dissolution de l’otium, le plan de l’existence (quand c’est férié, quand il aime, quand il prie) dans le negotium, le plan de la subsistance où quoi qu’il arrive l’on reste rivé à sa tâche. C’est ce qui accable Hölderlin, une situation face à laquelle il cherche un remède.
Hölderlin avait été formé au séminaire protestant du Monastère de Maulbronn avant de rejoindre le Grand séminaire protestant de Tübingen, le Sitft, en même temps que Hegel et Friedrich Wilhelm Joseph (von) Schelling. Ensemble, les trois amis écriront le projet du plus ancien programme systématique de l’idéalisme allemand dont voici un extrait :
« Je parlerai d’abord d’une idée qui, à ma connaissance, n’est encore jamais venue à l’esprit de personne — il nous faut une nouvelle mythologie, mais cette mythologie doit être au service des idées, elle doit devenir une mythologie de la raison.
Les idées qui ne se présentent pas sous forme esthétique, c’est-à-dire mythologique, n’ont pas d’intérêt pour le peuple, et inversement, une mythologie qui n’est pas raisonnable est pour le philosophe un objet de honte. Ainsi les gens éclairés et ceux qui ne le sont pas finiront par se donner la main, la mythologie doit devenir philosophique, afin de rendre le peuple raisonnable et la philosophie doit devenir mythologique, afin de rendre les philosophes sensibles. Alors on verra s’instaurer parmi nous l’unité éternelle. Plus de regard méprisant, le peuple ne tremblera plus devant ses sages et ses prêtres. Alors seulement on verra s’épanouir uniformément toutes les forces, celles du particulier comme celles de tous les individus. Aucune force ne sera plus réprimée, la liberté et l’égalité des esprits régneront partout ! — Un esprit supérieur, envoyé du ciel, doit fonder cette nouvelle religion parmi nous, elle sera la dernière, la plus grande œuvre de l’humanité ».
(Rédaction commune attribuée à Hölderlin, Hegel et Schelling. Traduction D. Naville. Dans Hölderlin ou la question de la poésie. Numéro hors série. Détours d’écriture. Sillages. Avril 1987).
Dans le fragment des lettres philosophiques, Hölderlin écrit :
« Ce n’est que dans la mesure où plusieurs êtres humains ont une sphère commune où ils souffrent et agissent humainement, c’est-à-dire autrement que pour la seule satisfaction des besoins, c’est seulement dans cette mesure qu’ils ont une divinité commune, et c’est seulement et s’il existe une sphère où tous les hommes vivent simultanément et à laquelle les rattache un lien supérieur à celui de la satisfaction des besoins vitaux, c’est à cette seule condition qu’ils ont tous une divinité commune »
( Hölderlin : [ De la religion] in Oeuvres. Pléiade p.648)
On pourrait presque voir cela comme une définition de l’otium du peuple, expression forgée par Bernard Stiegler pour se débarrasser de cet abrutissant opium du peuple de Marx.
Sociabilité et commun chez Hölderlin
Nous avons déjà quelques contenus de l’œuvre du poète qui suggèrent un communisme. Avant d’aller vers d’autres, examinons successivement ceux qui parlent de l’individuation et de la communauté. Dans un fragment intitulé La Jeunesse d’Hypérion cité par Philippe Jaccottet dans sa préface au roman épistolaire Hypérion, Hölderlin fait dire à Diotima :
« Je porte dans mon âme une image de sociabilité : grands dieux ! Comme elle fait apparaître plus beau d’être ensemble que seuls ! »
L’individualisme est aux antipodes des conceptions développées par Hölderlin. L’individuation, c’est à dire ce qui permet de devenir ce que l’on est, passe par l’ouverture aux autres et singulièrement à ce qui est étranger. Dans une lettre à son frère pour la nouvelle année 1799, le poète évoque la misère des « prisonnier de la glèbe » :
« Chacun ne se sent chez lui qu’à l’endroit où il est né ; son intérêt et ses conceptions peuvent et veulent rarement aller au-delà. D’où ce manque d’élasticité, d’élan, de déploiement multiple des forces, d’où le sombre, le méprisant refus, ou alors la dévotion craintive, aveuglément soumise avec laquelle ils accueillent tout ce qui se trouve en dehors de leur sphère étriquée et peureuse : de là aussi cette insensibilité quant à l’honneur commun et à la propriété commune, sans doute très générale chez les peuples modernes, mais qui, chez les Allemands, atteint à mon avis un degré suprême. Seul peut se complaire dans sa chambre celui qui vit aussi dans la liberté des champs ; de même, sans idées générales, sans vues universelles et sans regards ouverts sur le monde la vie individuelle propre à chacun ne peut exister »
Plus loin il précisera :
« Le guerrier engagé dans l’action commune se sent plus courageux et plus puissant et le devient effectivement ; de même l’énergie et la vitalité des hommes s’accroît dans la mesure où s’élargit le milieu où ils se sentent souffrir et agir en commun ( à condition que cette sphère ne s’élargisse pas au point que l’individu se perde dans le tout) ».
(Hölderlin : Lettre à son frère. 1er janvier 1799. in Hölderlin Oeuvres. Pleiade.Pp 689-690)
On notera chez Hölderlin et c’est une caractéristique de son œuvre, la recherche d’un équilibre entre deux tendances qui ne doivent pas s’absorber l’une l’autre sous peine de se nier, ici le chez soi et le dehors, l’individu et le collectif. De même, les individus isolés au labeur voient leurs capacités symboliques amputées, prolétarisées :
« Cependant, ô douleur ! Notre race, oublieuse des dieux est plongée
Dans la nuit. Sa demeure est semblable aux enfants. Et chacun, dans les chaînes
D’un geste défini, au milieu du tonnant atelier, n’entend
Que son propre travail. Ah ! le labeur de ces hommes farouches,
L’effort puissant des bras, la peine persévère et pourtant
Se révèle inféconde et pareille aux stériles Furies, et sera
Telle encor, jusqu’au jour où sortant de son rêve anxieux, l’âme des hommes
Juvénile et joyeuse soudain se lèvera ! »
(Hölderlin : Archipelagus / L’archipel. Pléiade p.828)
Les mains qui tenaient l’outil individuel deviennent des bras mécaniques. Hölderlin décrit un état de misère symbolique lié à la mécanisation des gestes corporels dans le vacarme de l’atelier qui les rend stériles en production symbolique. Le « geste défini » est un choix du traducteur. L’expression n’existe pas chez Hölderlin sinon l’on pourrait parler de grammatisation. C’est à un réenchantement du monde que se consacre l’œuvre de Hölderlin.
La communauté chez Hölderlin
Dans un article Communion républicaine/La communauté selon Hölderlin, Pierre Hartmann décline le motif de la communauté dans Hypérion et La mort d’Empédocle. Il y a d’abord le cercle familial, ce que Hölderlin appelle Les miens, titre de l’un de ses poèmes de jeunesse. C’est la « communauté affective originaire, mais aussi communauté-refuge devant les déboires de la vie ». Il y a ensuite les amis avec qui « il importe tant de faire cause commune », car
« nous nous faisons tort à nous-mêmes lorsque, par une misérable rivalité, nous nous séparons et nous isolons, car l’appel de l’ami nous est indispensable pour nous réconcilier avec nous-mêmes ».
(Hölderlin : Lettre à Neuffer in Œuvres. Pléiade. P. 449)
Nous avons déjà vu la relation de Hölderlin avec Schelling et Hegel. « le mot-clé de cette relation est celui de Bund (lien, association, alliance, pacte) », le Bund unserer Geister, l’alliance de nos esprits.
« la communauté amicale ne doit en aucune façon être tenue pour une communauté exclusive, une communauté par soustraction. Elle n’épouse pas la figure du repli, mais celle de la projection : le Bund amical se veut une anticipation, une préfiguration de l’église universelle, c’est-à-dire de la communauté générale des hommes. Si pacte il y a entre un nombre restreint d’individus choisis, alliance entre des âmes d’élite, c’est en vue de l’idéal de toute société humaine, de l’église esthétique.» (Pierre Hartmann : article cité)
A son frère Karl, Hölderlin écrit : « Il n’existe au monde qu’un seul litige, celui de savoir si c’est le tout ou le particulier qui prédomine » (Pléiade p. 996). « L’essentiel, c’est qu’en toute chose l’esprit de communauté prévaudra », avait-il déjà avancé dans une lettre précédente au même (p. 986).
Dans un brouillon de lettre à Casimir Ulrich Böhlendorff, le poète utilise l’expression de « Psyché entre amis » :
« Ecris-moi bientôt sans faute. J’ai besoin de tes pures sonorités. La Psyché entre amis, la naissance de la pensée dans la conversation et la correspondance est nécessaire aux artistes. Autrement nous n’avons aucune pensée pour nous-mêmes ; elle appartient à l’image sacrée que nous formons »
(Pleiade p. 101o-11)
Il y aussi ce que Maurice Blanchot appelle « la communauté des amants » qui n’exclut pas la séparation, ni ne s’isole.
« Restreinte ou générale, érotique ou politique, la communauté s’inscrit en permanence dans l’horizon du possible. Mais elle est aussi réellement présente, à tout moment, comme le grand Tout de la nature où chacun peut trouver refuge, fut-ce dans la mort »,
écrit Pierre Hartmann. Il y a enfin la communauté des habitants devenus citoyens comme dans La mort d’Empédocle.
Toutes ces communautés peuvent être bonnes ou mauvaises, ouvertes ou fermées comme, par exemple, la secte de Némésis dans Hypérion.
„Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen, die alles Bisherige schamrot machen wird.“
« Je crois à une future révolution des conceptions et manières de voir qui éclipsera [fera rougir de honte] tout ce qu’on a connu dans le passé »
Le problème de Hölderlin et de ses amis est la transformation de la société allemande, et singulièrement du Pays souabe, au moment où se déploie avec ses vices et ses vertus la Révolution française. La France est vécue à la fois comme maladie et comme cure, pour reprendre, en l’inversant, la proposition de Jean Pierre Lefebvre (cf Jean Pierre Lefebvre : Hölderlin : La France comme cure et comme maladie in Nicole Parfait (éd) Hölderlin et la France. L’Harmattan 1999.)
Gesinnungen ici traduit par les deux mots conceptions et manières de voir a chez Kant, dont Hölderlin fut un lecteur assidu, une dimension éthique, celle qui préside à la volonté telle qu’elle ne se soucie pas de son succès ou de ses effets utilitaires. La phrase citée est extraite d’une magnifique lettre à Johann Gottfried Ebel à Paris, aussi déçu par la Révolution française qu‘il en fut un ardent partisan. Hölderlin y développe toute une pharmacologie dans sa lecture du chaos des évènements qui se déroulent en France où s’est installé le Directoire. Elle est datée du 10 janvier 1797. Il écrit :
« C’est merveilleux, cher Ebel ! d’être déçu et navré comme vous l’êtes ! S’attacher à la vérité et à la justice au point de les voir même où elles ne sont pas, cela n’est pas donné à tout le monde, et quand l’esprit observateur est à ce point subjugué par le cœur, on peut se dire que ce cœur est trop noble pour son siècle. Il est à peu près impossible de regarder la réalité sordide dans toute sa nudité, sans en tomber malade soi-même »
Certes, cela rend malade mais
« vous le supportez malgré tout, et je vous admire autant pour avoir encore envie de regarder ces choses que pour ne pas les avoir vues plus tôt de la même manière ».
Dans le premier temps de la déception, il reste « quelques-uns » pour préparer la suite :
« Je sais qu’il est infiniment douloureux de prendre congé d’un endroit où l’on a vu s’épanouir dans nos espoirs tous les fruits et toutes les fleurs de l’humanité. Mais il nous reste nous-mêmes et quelques-uns, et n’est-ce pas une belle chose aussi que de trouver tout un monde en soi-même et en quelques-uns ? »
Car sur un plan plus général, le chaos contient en germes une renaissance :
« je me console à l’idée que toute fermentation et toute dissolution aboutissent nécessairement soit à l’anéantissement, soit à une organisation nouvelle. Mais il n’y a pas d’anéantissement, donc la jeunesse du monde doit resurgir de notre décomposition. On peut bien dire avec certitude que jamais monde n’a présenté un aspect aussi chaotique qu’à présent. Il n’est qu’une infinie variété de contrastes et d’oppositions ! De l’ancien et du nouveau ! Culture et sauvagerie ! Méchanceté et passion ! Égoïsme sous peau de mouton ! Égoïsme sous peau de loup ! Superstition et incrédulité ! Servitude et despotisme ! Intelligence dénuée de bon sens ! Bon sens dénué d’intelligence ! Sensibilité dépourvue d’esprit, esprit dépourvu de sensibilité ! Histoire, expérience, tradition sans philosophie, philosophie sans expérience ! De l’énergie sans principes ! Des principes sans énergie ! De la rigueur dénuée du sens de l’humanité ! Un sens de l’humanité dénué de rigueur ! De la complaisance où perce l’hypocrisie, de l’arrogance éhontées ! Des jeunes qui font le barbon, des hommes puérils – On pourrait poursuivre cette litanie de l’aurore à la nuit sans avoir dénombré la millième partie du chaos humain. Mais il faut qu’il en soit ainsi ! Cette caractéristique d’une partie, la mieux connue, de l’espèce humaine présage certainement des choses extraordinaire. Je crois à une future révolution des conceptions et manières de voir qui éclipsera tout ce qu’on a connu dans le passé ».
(Hölderlin : Lettre à Johann Gottfried Ebel in Oeuvres. p. 403-404)
Révolution est à prendre ici au sens de rendre un passé révolu. Lettre d’une saisissante actualité où le chaotique est à la fois dissolution souhaitable, il faut qu’il en soit ainsi, et fermentation des germes de renouveau. La dissolution chez Hölderlin n’est pas une négation ou un renversement. C’est un processus d’ouverture vers des possibles permettant la construction d’un à venir ouvert lui-même sur l’infini en transformant le présent et en constituant ce qui est révolu en passé. Faute de quoi non seulement celui-ci ne passe pas – c’est le retour des rois, la contre-révolution – mais on risque de perdre les possibles non réalisés, l’humus, qu’il contient. Hölderlin appelle cela « le devenir dans le périr », titre de l’un de ses essais dans lequel il écrit :
« Ce qui passe à la négation, dans la mesure où il provient de la réalité effective, et n’est pas encore un possible ne peut agir effectivement. Mais le possible qui rentre dans la réalité effective, tandis que se dissous la réalité effective, celui là agit effectivement et produit aussi bien la sensation de la dissolution que le souvenir de ce qui a été dissous »
La « vie neuve », pour durablement exister, doit aussi produire « une anamnèse de ce qui a été dissous ». Si cette lacune n’est pas comblée, elle le sera par une idéologie décliniste ravageuse. Je dois cette lecture de la dissolution à travers la traduction, différente de celle de la Pléiade, qu’elle cite, au fort intéressant livre de Judith Balso : Ouvrir Hölderlin. Éditions Nous. 2022.
Bien entendu, la dissolution ne se décrète pas. Et encore faudrait-il repérer les forces disruptives à l’œuvre que nous savons aujourd’hui technologiques et numériques, question que Hölderlin n’aborde pas.
Communisme
Joseph Albernaz, dans son article, cite un passage d’Hypérion qui lui semble revêtir une pertinence particulière pour comprendre le sens de Communisme des esprits. Il s’agit de la lettre envoyée par Diotima, depuis son lit de mort, à Hypérion :
« Je me suis élevée au-dessus de ces fragments à quoi se réduit toute œuvre humaine (littéralement : faite des mains des humains, Menschenhände), j’ai ressenti la vie de la Nature qui s’élève au-dessus de toutes les pensées – deviendrais-je même une plante, le mal serait-il si grand ? – Je serai. Comment pourrais-je me perdre hors de la sphère de la vie où l’amour éternel, commun à toutes choses, rassemble toutes les natures ? Comment sortirais-je de l’alliance (Bund) qui unit toutes les créatures. Elle ne se rompt pas aussi aisément que les liens lâches de l’époque (die losen Bande dieser Zeit). Elle n’est pas une foire où le peuple s’assemble avec bruit pour bientôt se disperser à nouveau. Non ! par l’Esprit qui nous unit, par l’Esprit divin qui est propre à chacun et commun à tous (der jedem eigen ist und allen gemein) ! Non ! Non ! dans l’alliance de la Nature, la fidélité n’est pas un rêve. Nous ne nous séparons que pour être plus intimement unis, plus divinement accordés à toutes choses et à nous-mêmes. Nous mourrons pour vivre. (Wir sterben, um zu leben)
Je serai. Je ne demande pas ce que je deviendrai. Être, vivre est assez. C’est la gloire des dieux ; c’est pourquoi tout ce qui est vie dans le monde divin ignore l’inégalité, et il n’y a ni maîtres ni serviteurs (es gibt in ihr nicht Herren und Knechte. Knecht n’est pas l’esclave mais le serviteur). Les natures vivent les unes avec les autres comme des amants ; elles ont tout en commun : l’esprit, la joie et l’éternelle jeunesse »
(Hölderlin : Hypérion. Oc pp. 225-226)
La « foire où le peuple s’assemble avec bruit pour bientôt se disperser à nouveau » n’est pas sans rappeler la lettre de Hölderlin à sa sœur citée plus haut « Aujourd’hui, c’est la grande foire » où l’on se fait « bousculer de droite et de gauche par la cohue ».
Pour Joseph Albernaz, il est difficile de trouver une meilleure description pour l’idéal exprimé dans ce passage qu’un « communisme des esprits » au vu du nombre d’occurrences mettant en relation l’esprit et le commun. Le « tout en commun » lui rappelle le omnia sunt communia (Tout est commun à tous) de Thomas Müntzer. La référence indirecte à la Guerre des Paysans en Allemagne est d’autant plus intéressante que l’historien suisse, Peter Blickle, qualifie la Guerre des paysans de Révolution de l’homme du commun. Il définit ce dernier, qu’il distingue de la notion de peuple, comme principalement anti-autoritaire. Il a montré la place qu’occupait l’idée communaliste dans leurs conceptions : aussi bien dans les villages que dans les villes, « toutes leurs représentations politiques étaient orientées vers la commune (Gemeinde)». (Peter Birckle : Der Bauerkrieg/ Die Revolution des gemeinen Mannes. CH Beck)
Il y a aussi dans Hypérion, dont je rappelle que le nom vient du grec ancien Ὑπερίων , Huperíōn (« celui qui va au-dessus »), au-dessus précisément de la fragmentation de la vie ordinaire évoquée par Diotima, et que Nietzsche qualifiera de sur-humain, ce cri de ralliement proprement guerrier :
« Tout pour tous. Chacun pour tous » (p. 182).
Enfoncés les Trois mousquetaires !
Si communisme il y a chez Hölderlin, il ne s’agit en aucun cas d’un communisme qui mène à la dictature du prolétariat, qui était d’ailleurs plutôt une dictature sur le prolétariat, encore moins à une dictature du KGB et de ses clones. Ni même à la constitution d’un État du moins en ce que celui-ci a aussi une dimension toxique :
Hypérion :
« Tu concèdes à l’État, me semble-t-il, trop de pouvoir. Il n’a pas le droit d’exiger ce qu’il ne peut obtenir par la force ; or, on ne peut obtenir par la force ce que l’amour donne, ou l’esprit. Que l’État ne touche donc point à cela, sous peine que l’on ne le cloue au pilori! Par le Ciel ! il ne mesure pas l’étendue de son péché, celui qui prétend faire de l’État l’école des mœurs. L’État dont l’homme a voulu faire son ciel s’est toujours transformé en Enfer.
– L’État n’est rien de plus que la rude écorce protégeant l’amande de la vie [Kern des Lebens], le mur enfermant le jardin de nos fruits et de nos fleurs.
– Mais que peut faire le mur si la terre du jardin est sèche ? La seule pluie du ciel y peut quelque chose.
– Pluie du ciel, ô ferveur ! Tu nous ramèneras le printemps des nations. L’État ne peut disposer de toi ; »
Quand le printemps des peuples ?
« Quand la préférée du Temps , sa plus jeune, sa plus belle fille, la nouvelle Église, surgira de ses formes désuètes et souillées, quand le réveil du sens du divin rendra à l’homme son dieu et au cœur sa jeunesse, quand … je ne puis l’annoncer, car c’est à peine si je la pressent, mais je ne doute pas qu’elle vienne ». (Hypérion, oc. p. 83-84)
La « nouvelle Église » est à comprendre à partir de son étymologie, ecclesia, l’Assemblée regroupant des énergies de bifurcation, à distance non seulement de l’État mais de toute forme de sectarisme. Au moment où Hypérion s’exaltait ainsi, déboule dans la chambre une bande de sectaires, partisans de la terreur, indifférents à l’adhésion des humains à leur projet, dont l’aspect de détenteurs de la « Toute-science », Allwissenheit, provoque en lui l’effroi.
La faute d’ Empédocle

 Follow
Follow



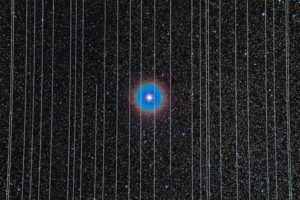

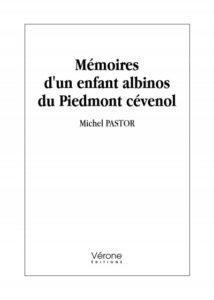
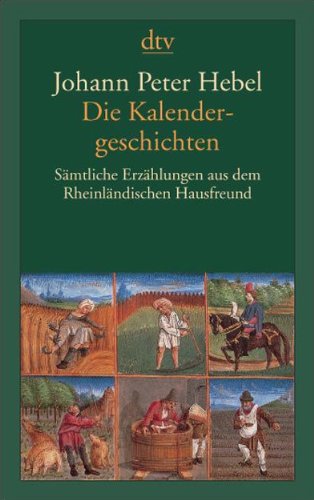
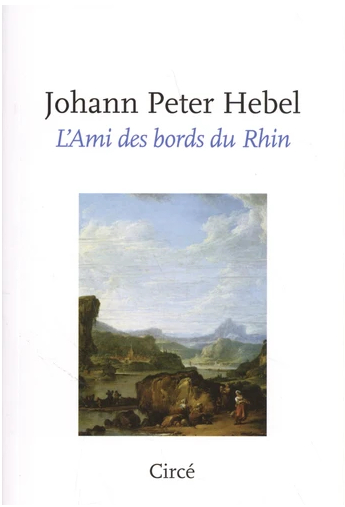
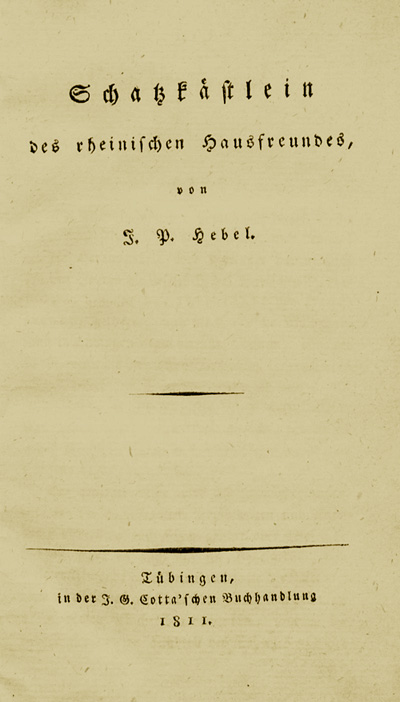
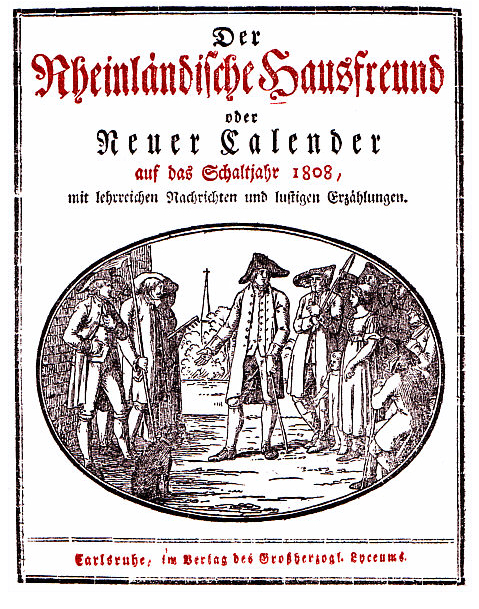









Pour une vraie place des littératures en langues régionales dans les programmes scolaires (Pétition)
Il est temps d’accorder une vraie place aux littératures en langues régionales dans les manuels scolaires. Tous les élèves de France doivent savoir qu’il existe, en France, quantité d’auteurs qui se sont exprimés et s’expriment encore dans d’autres langues que le français, y compris un prix Nobel de littérature (Frédéric Mistral). Le Collectif pour les littératures en langues régionales à l’école a adressé une lettre-pétition en ce sens au Ministre de l’Éducation nationale.
Vous en trouverez le texte ci-dessous
Je m’y associe d’autant plus volontiers que le SauteRhin consacre une partie de son activité à transmettre ces trésors. Pour ce qui concerne l’Alsace, cela s’est fait à travers Nathan Katz, Jean-Paul Klée, René Schickele, cet autre Prix Nobel (de la paix) Albert Schweitzer, Claude Vigée, Otfrid von Weißenburg, j’en oublie. Littérature est à comprendre au sens large. Nous y incluons par exemple la chanson et la musique. Pour enseigner, il faut des enseignants. Je rappelle la proposition de Jean-Paul Sorg pour une École normale rhénane. La question concerne aussi notre histoire falsifiée.
Cette pétition demande au ministère de l’Éducation nationale d’enrichir ses programmes pour faire enfin une place, au côté des littératures en français, aux autres littératures de France. Je l’ai moi-même signée et vous invite à en faire de même en suivant le lien vers la pétition.
Auteur(s) :
Collectif pour les littératures en langues régionales à l’école
Destinataire :
Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale
Monsieur le Ministre,
Le patrimoine littéraire français ne se limite pas aux productions écrites en langue française. Depuis des siècles, la création poétique, narrative, théâtrale, argumentative en langues dites « régionales » est abondante et éminemment digne d’intérêt.
Or, comme ce fut longtemps le cas de la littérature féminine, tout cet archipel de créations écrites est aujourd’hui largement ignoré par les programmes scolaires de notre pays. Et donc par la majeure partie des Français.
Afin de mettre un terme à cette injustice, nous demandons que ces programmes soient reconsidérés et intègrent officiellement l’enseignement d’œuvres créées par des autrices et auteurs qui, pour être ancrés dans leur culture « régionale », n’en ont pas moins une portée universelle.
La France ne s’émeut guère d’une contradiction profonde entre ses déclarations d’intention et son action réelle. Elle s’enorgueillit de posséder une littérature mondialement reconnue, récompensée cette année encore par un prix Nobel, attribué à une femme. Elle se bat sans relâche, sur la scène internationale, pour que la langue française et sa littérature soient respectées et diffusées. Elle prodigue à tous ses enfants un enseignement qui accorde une place ambitieuse et méritée à nos œuvres littéraires.
Et pourtant, dans ce pays tellement attaché à la culture et aux droits de l’Homme, on peut constater avec effarement que la plupart de nos concitoyens ignorent qu’il existe des milliers d’œuvres littéraires écrites chez nous dans d’autres langues que le français.
S’ils ne le savent point, c’est bien, hélas ! Parce que notre système éducatif ne leur a jamais enseigné cette réalité. Héritier d’une tradition de mépris remontant à l’Ancien Régime puis théorisée sous la Révolution par l’abbé Grégoire, ce système passe volontairement sous silence ces milliers d’œuvres ainsi que ceux qui les ont écrites et les écrivent aujourd’hui encore, malgré les difficultés qu’ils rencontrent.
Les langues « régionales » elles-mêmes, dont l’enseignement demeure soumis au régime de l’incertitude et de la précarité, malgré les rappels à l’ordre répétés des instances culturelles internationales, se voient dédaignées par les autorités de ce pays.
Car le fait qu’au fil des ans, et non sans mal, quelques améliorations aient pu être apportées à leur statut grâce à quelques textes législatifs ou réglementaires n’empêche pas que trop souvent, faute de moyens et de bonne volonté de la part des décideurs de terrain, l’application concrète de ces textes soit fortement entravée. A fortiori, les littératures de ces autrices et auteurs – alsaciens, basques, bretons, catalans, corses, créoles, flamands, occitans, et de toute autre langue de France, y compris bien sûr des outre-mer – sont victimes d’une idéologie étriquée, exclusive et excluante.
Quand on trouve dans les manuels une référence, par exemple à tel ou tel troubadour, cela reste marginal et parfois scientifiquement erroné. Il est grand temps que cette situation évolue.
Au fond, rien n’empêche – si ce n’est certaines volontés politiques influentes et figées – qu’un enseignement portant sur ces œuvres et ces autrices et auteurs soit dispensé aux élèves, au fil des divers cycles, du primaire jusqu’au baccalauréat. Il est parfaitement envisageable de les faire étudier, en traduction française ou, mieux encore, en version bilingue. Contes, poèmes, romans, pièces de théâtre… Peuvent être abordés sous forme d’extraits ou d’œuvres intégrales. Par exemple dans le cadre des progressions pédagogiques de la matière français ou, en lycée, dans celui de l’enseignement de spécialité « humanités, littérature et philosophie », on aborde déjà fréquemment des textes d’auteurs traduits de langues étrangères ou de l’Antiquité : il est parfaitement possible d’y intégrer les textes dont nous parlons, des œuvres de qualité qui pourraient dialoguer avec la littérature européenne écrite dans d’autres langues, dont le français.
On pourrait aussi considérer que les enseignants de chaque région mettent prioritairement l’accent sur des œuvres issues de celle-ci mais, au-delà de ce principe, il serait bon que chaque élève soit sensibilisé à l’existence de cette foisonnante diversité littéraire de notre pays.
Si Annie Ernaux est « notre » nouveau prix Nobel de littérature, Frédéric Mistral, en son temps, le fut aussi. Il écrivait en provençal, et de cela la quasi-totalité des Français n’a strictement aucune connaissance. Œuvrons pour mettre un terme à cette aberration. Agissons au bénéfice de tous, à commencer par notre jeunesse : l’ouverture des programmes sur notre diversité interne est un premier pas vers un nouvel humanisme ouvert à l’Autre.